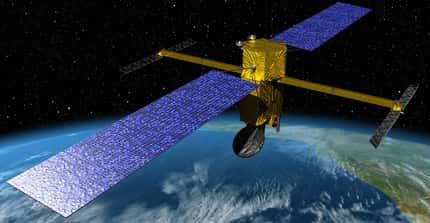au sommaire
La civilisation maya nous fait rêver depuis longtemps... On oublie souvent, que malgré ses aspects raffinés - les prêtres mayas étaient de bons astronomesastronomes et des mathématiciensmathématiciens suffisamment brillants pour avoir découvert le concept du zéro -, c'était aussi un monde très barbare avec des sacrifices humains horribles et une société finalement peu démocratique. Les Mayas n'étaient pas unis et la population était divisée en cités-États, souvent en guerre les unes avec les autres.
Reste que l'on connaît tous des noms de cités mayas comme Palenque, Chichén Itzá et que toutes sortes de légendes leur sont associées, allant de la fameuse prophétie de la fin du Monde pour 2012 à l'arrivée des fameux astronautesastronautes extraterrestres, quand ce n'est pas en relation avec le mythe de l'Atlantide ou celui du continent perdu de Mu que les fans de la série Les mystérieuses cités d'or connaissent bien.
L'architecture maya est tout aussi mystérieuse et inspirante et on aimerait bien comprendre pourquoi brutalement, vers l'an mille de notre calendrier, les cités-États ont été désertées et les constructionsconstructions qu'elles abritaient ont cessé d'être entretenues ou multipliées. Plusieurs hypothèses ont été proposées sans que les débats ne permettent de trancher.
La vérité sur Palenque. Découvrez les secrets des anciens Mayas. © Musée canadien des civilisations (MusCanCiv)
Il semble cependant que l'occurrence de sécheresses vers cette période, causant l'effondrementeffondrement physiquephysique et culturel du monde maya, soit une hypothèse qui prend de plus en plus de poids les années passant. Nous en avons un nouvel exemple avec une publication dans le journal Science d'un article provenant d'une équipe de chercheurs des universités de Cambridge (Royaume-Uni) et Floride (États-Unis).
Une pluviosité réduite en moyenne de 41 à 54 % en pays Maya
On peut penser en effet que des famines provenant de sécheresse et frappant à répétition sur une assez longue duréedurée ont non seulement exacerbé les conflits entre cités-États mais aussi sapé la confiance dans les pouvoirs des prêtres et des nobles censés être capables d'intercéder avec les dieux.
Pour consolider cette hypothèse, il faut être en mesure de prouver que ces sécheresses se sont bien produites mais surtout qu'elles étaient bien suffisamment fortes pour provoquer la chute de la civilisation maya de l'époque classique terminale (800-1000 après J.-C.). Pour cela, des géochimistes se sont attaqués à la détermination des abondances de plusieurs isotopesisotopes de l'oxygène et de l'hydrogènehydrogène présents dans le gypsegypse de couches sédimentaires déposées pendant cette époque au fond du lac de Chichancanab, au Yucatán, en plein pays Maya.
Le saviez-vous ?
L'idée derrière la méthode est la suivante. En cas de sécheresse, le taux d'évaporation du lac augmente et les eaux se concentrent du fait de la diminution des apports d'eau. Les isotopes légers de l'oxygène et de l'hydrogène quittent les eaux du lac plus facilement que les isotopes plus lourds, comme l'oxygène 18 et le deutérium, de sorte que la formation du gypse (une roche évaporitiqueroche évaporitique formée de sulfate dihydraté de calciumcalcium de formule CaSO₄·2H₂O) se déroule avec un enrichissement en ces isotopes.
L'étude du gypse a permis d'établir solidement que les précipitations annuelles ont diminué de 41 % à 54 %, avec des pics de réduction de 70 % pendant la période où la civilisation maya s'effondre. Voilà une base sur laquelle on va pouvoir discuter pour évaluer l'impact réel de ces sécheresses sur la population maya.
Une sécheresse a-t-elle eu raison des Mayas ?
Article de Jean-Luc GoudetJean-Luc Goudet publié le 05/01/2007
Selon une équipe internationale, la zone tropicale nord a connu une période de forte sécheresse entre 700 et 900 de notre ère, curieusement simultanée de la chute de deux grandes civilisations, les Mayas, au Mexique, et la dynastie Tang, en Chine.
En reconstituant 16.000 ans de moussons d'Asie et d'Australie, des chercheurs allemands, américains et chinois ont découvert trois épisodes climatiques particuliers, qui auraient provoqué une grande sécheresse au nord de l'équateur. Le dernier se serait déroulé entre 700 et 900 après Jésus-Christ et les auteurs suggèrent que cette sécheresse a contribué à la chute de deux civilisations, la dynastie chinoise Tang et les Mayas, qui, dans les deux cas, s'est produite à la fin de cette période.
Ces géologuesgéologues ont étudié les sédimentssédiments du lac Huguang MaarMaar, au sud-est de la Chine. Par l'analyse des propriétés magnétiques et la teneur en titanetitane, les scientifiques affirment avoir reconstitué avec une haute résolutionrésolution la force des ventsvents durant les moussons d'hiverhiver. Ce résultat est déjà en soi intéressant car, expliquent les auteurs de l'article, alors que la mousson d'été peut être lue assez facilement, notamment par des dépôts dans les grottes, celle d'hiver est difficile à retrouver.
Conclusion : les vents d'hiver se sont montrés particulièrement violents durant plusieurs périodes. La première a précédé une phase de réchauffement brutal déjà connue, dite Bølling-Allerød, survenue il y a un peu plus de 14.000 ans. La deuxième s'est déroulée durant le DryasDryas récent (14.000 - 9.000 avant le présent), une période de refroidissement terminée par un réchauffement très brutal. La troisième, enfin, a eu lieu au moment où Tang et Mayas voyaient leur culture décliner. Durant ces trois phases de moussons d'hiver à vent violents, les géologues notent, grâce aux stalagmitesstalagmites, que les pluies des moussons d'été ont au contraire été plus faibles.
Des traces dans les sédiments et dans l'histoire
Cette corrélation entre vents violents en hiver et sécheresse estivale conduit les auteurs à accuser des migrations vers le sud de la zone de convergencezone de convergence intertropicale, ce vaste secteur de basses pressionspressions équatoriales, qui impose le régime des pluies dans toute la zone tropicale. Les étés seraient alors devenus très secs. Or, une telle migration a déjà été mise en évidence au Venezuela (par l'analyse des sédiments) pour la période 700 à 900 de notre ère.
La chute de la brillante société maya, survenue à partir de l'an 900, a donné lieu à bien des interprétations. À cette époque, la construction de pyramides cesse et certains sites sont abandonnés. Une partie de la population semble avoir quitté les basses terresterres pour gagner, au nord, la péninsulepéninsule du Yucatán et, au sud, les hauteurs de l'actuel Guatemala.
Pour le spécialiste français Christian Duverger, on ne devrait même pas parler de disparition. La culture et le pouvoir maya auraient progressivement régressé face à l'influence des Toltèques, descendants des Nahuas, un peuple du plateau central du Mexique et qui a construit Teotihuacan (voir L'Histoire, numéro spécial Comment meurent les civilisations, daté de janvier 2007). Du côté des Tang, cette dynastie a subi en 751 une grave défaite militaire faces aux armées arabes et a sans doute eu du mal à s'en remettre. Peut-être faut-il éviter de chercher une explication unique...
Ce qu’il faut
retenir
- Il y a environ mille ans la civilisation des cités mayas s'effondre.
- Une explication possible est celle d'une sécheresse persistante accentuant les tensions et les guerres entre les cités concurrentes et sapant la confiance dans l'élite censée communiquer avec les dieux.
- Les isotopes lourds de l'oxygène et de l'hydrogène retrouvés plus nombreux dans les cristaux de gypse au fond d'un lac démontrent en effet la survenue à cette époque d'une grande sécheresse.
- Reste à montrer qu'elle était suffisante pour provoquer un effondrement total, économique et culturel.