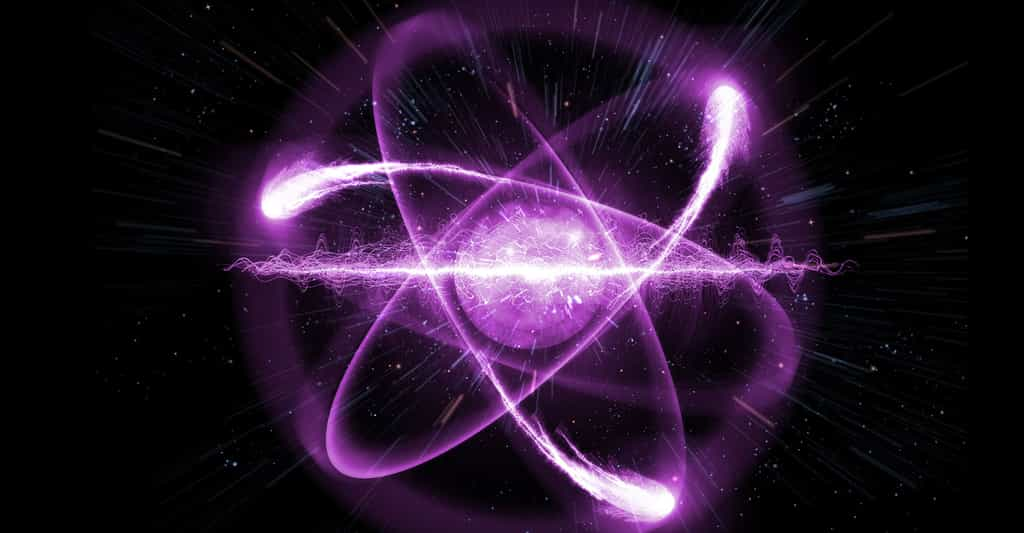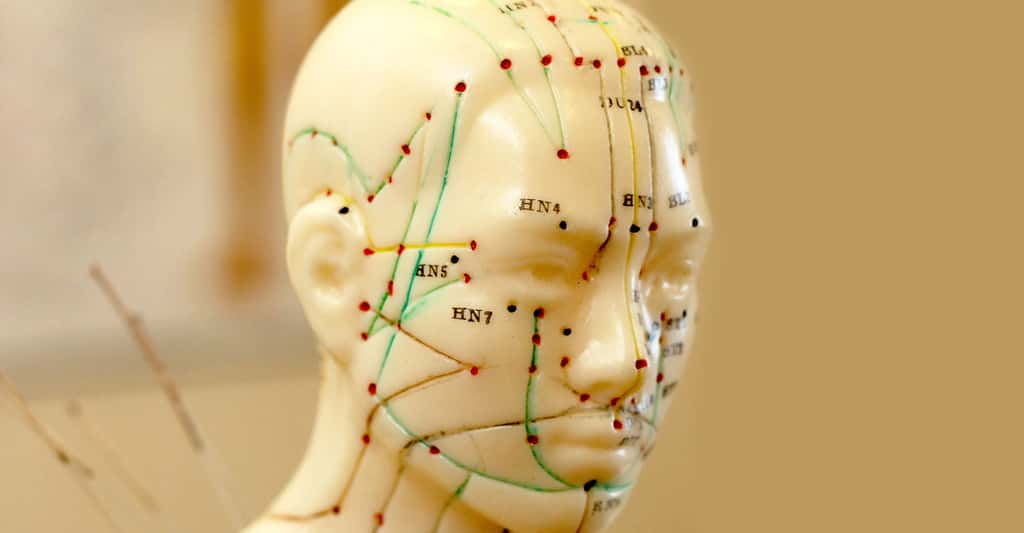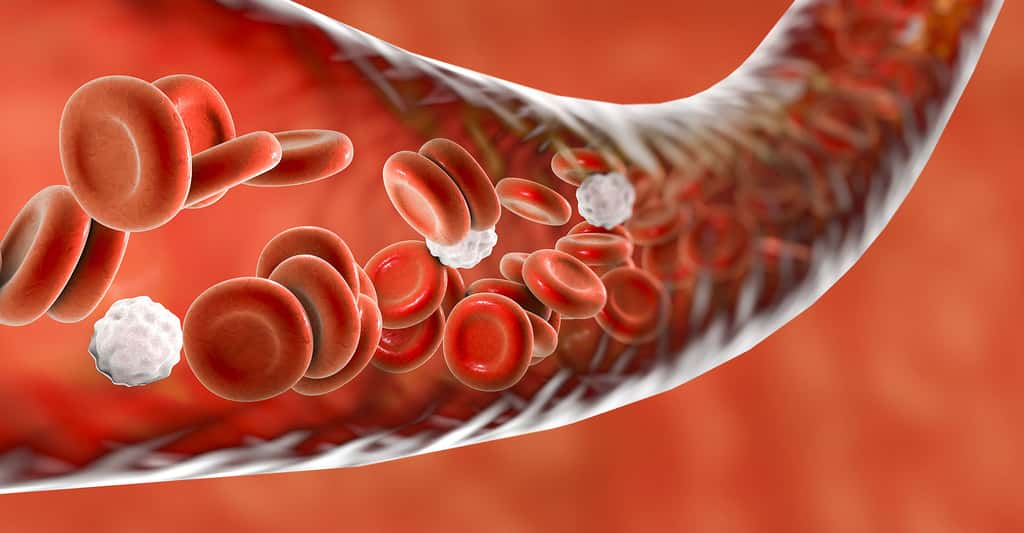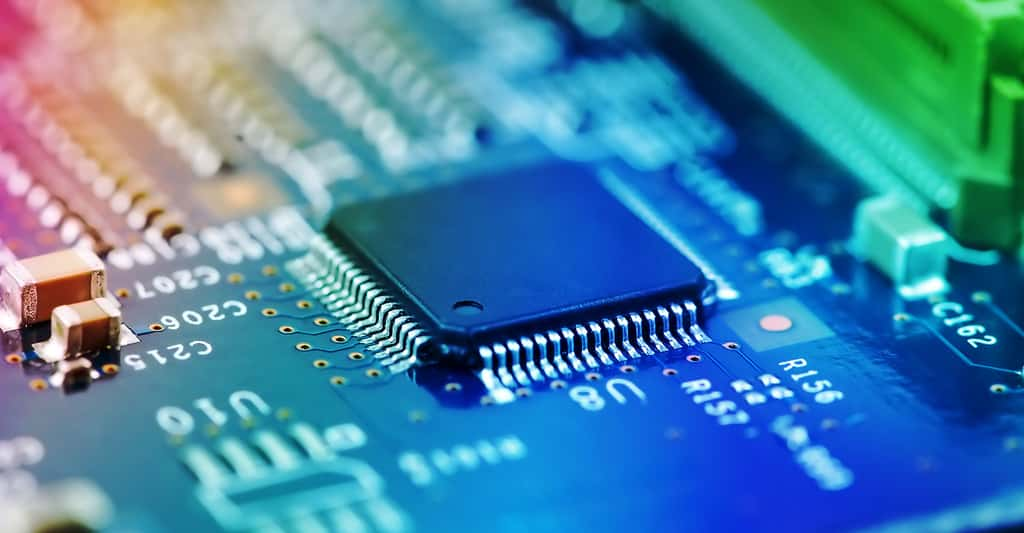au sommaire
- À lire aussi
De nombreuses études sur le monde subatomique ont montré que les particules telles que les électrons ou les photons sont différentes des objets avec lesquels nous interagissons quotidiennement. Ces entités semblent posséder les caractéristiques des ondes et des particules, en fonction de l'expérience ou du phénomène observé. Bienvenue dans le monde étrange de la mécanique quantique.
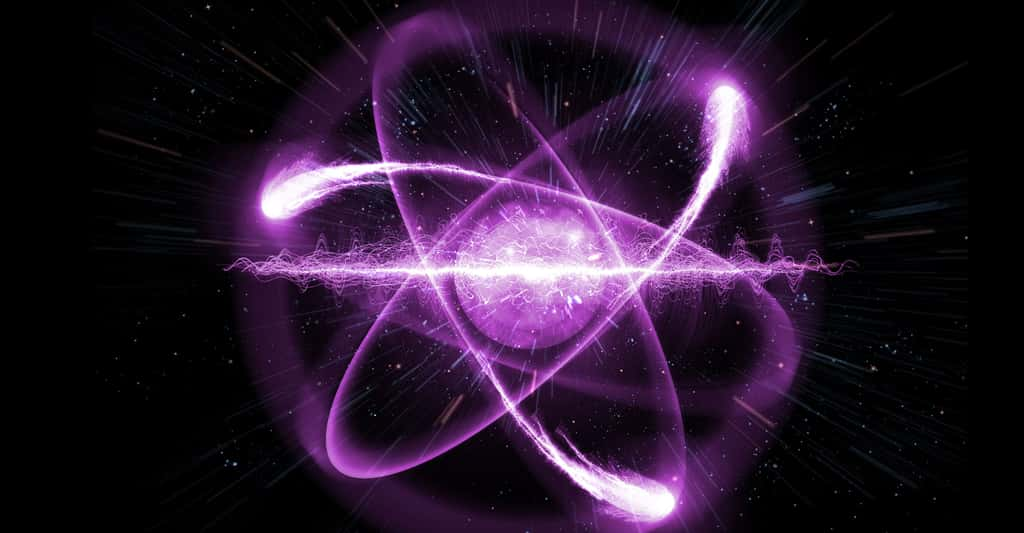
En 1999, des chercheurs de l’université de Vienne démontrèrent le comportement ondulatoire des molécules de buckminsterfullerène, formées de 60 atomes de carbone (ci-dessus). Un faisceau de molécules (avec une vitesse de 200 m/s environ) était projeté à travers une grille, provoquant un modèle d’interférence caractéristique des ondes. © Ezume Images - Shutterstock
En 1924, le physicienphysicien français Louis-Victor de Broglie, septième duc de Broglie (1892-1987) suggéra que les particules de matière pouvaient aussi être considérées comme des ondes et possédaient les propriétés communément associées aux ondes, y compris la longueur d’onde (la distance entre les crêtes successives de l'onde). En réalité, tous les corps possèdent une longueur d'onde.
En 1927, Clinton Joseph Davisson (1881-1958) et Lester Halbert Germer (1896-1971) démontrèrent la nature ondulatoire des électrons en montrant qu'ils peuvent diffracter et interférer au même titre que la lumièrelumière.
La fameuse relation de de Broglie montrait que la longueur d'onde d'une onde de matière est inversement proportionnelle à la quantité de mouvementquantité de mouvement de la particule (soit la massemasse multipliée par la vitessevitesse), et, en particulier, λ = h/p. Ici, λ désigne la longueur d'onde, p la quantité de mouvement et h la constante de Planck. Avec cette équationéquation, il est possible de montrer que les objets « plus gros », comme les roulements à billes, présentent des longueurs d'onde minuscules, invisibles à l'œilœil nu, ce qui explique que nous ne puissions pas observer leur comportement ondulatoire. La longueur d'onde d'une balle de tennis qui traverse un court est de 10-34 m, bien plus petite que la largeur d'un protonproton (10-15 m). La longueur d'onde d'une fourmifourmi est supérieure à celle d'un humain. Depuis l'expérience originale de Davisson-Germer sur les électrons, l'hypothèse de de Broglie a été confirmée pour d'autres particules comme les neutronsneutrons et les protons et, en 1999, pour l'ensemble des moléculesmolécules telles que les buckminsterfullerènes, molécules en forme de ballonsballons de football et composées d'atomesatomes de carbonecarbone. De Broglie avait émis son idée dans sa thèse, mais elle était si radicale que les examinateurs hésitèrent à lui accorder son doctorat. Par la suite, ces travaux lui valurent le prix Nobel.