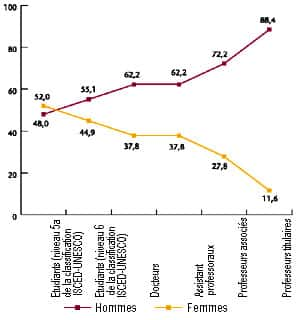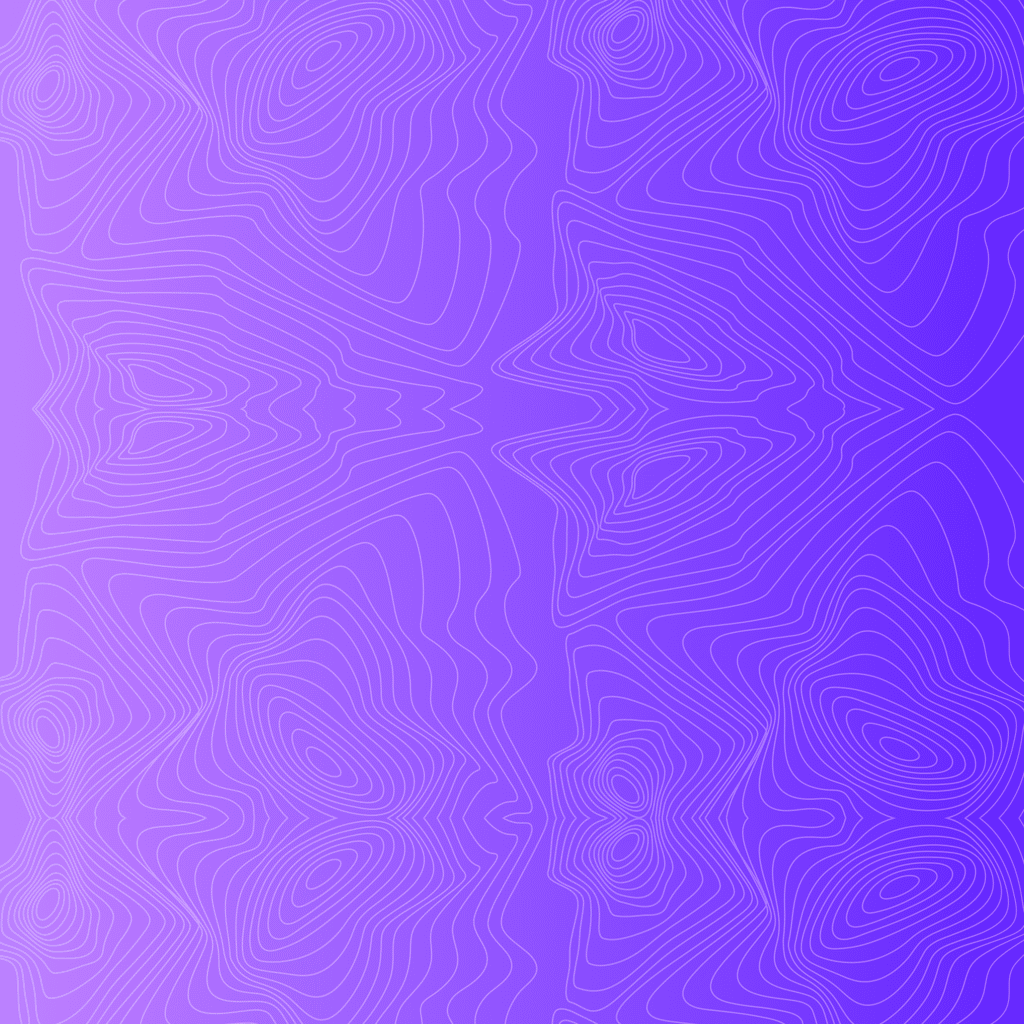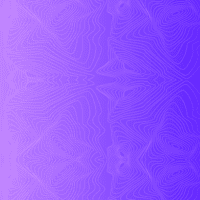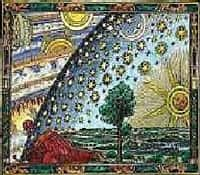au sommaire

La recherche ? Quel métier…
La vie de chercheur ressemble à la recherche. Une suite de questions. Bien souvent, ceux qui s'y lancent y pensent depuis longtemps. Cela peut s'appeler une vocation. Cela ressemble en tout cas à une passion. Un doctorat, des post-doctorats, des bourses et des contrats temporaires, un poste qui se libère, la possibilité de bifurquer, les hésitations et les certitudes, la concurrence et la chasse aux subsides, les projets qui piétinent et puis se dénouent. Le tout épicé d'un peu de chance, de quelques hasards, de beaucoup d'intuition et d'imagination.
- Je suis fils d'enseignants.
Aussi loin que je me souvienne, vers l'âge de dix ans, le métier de chercheur me semblait connoté très positivement et je me rappelle l'avoir ensuite désigné clairement comme mon souhait lors de séances d'orientation professionnelle. Il s'agit donc d'une vocation, mais celle-ci n'est probablement pas due au hasard puisque je suis issu d'un milieu à fort capital culturel et faible capital économique", explique Pablo Achard, physicienphysicien français, post-doctorant au CERN (Genève). Vocation? Une sorte d'"appel", entre désir et certitude, qui vous viendrait de l'enfance et aurait été "validé" par des rencontres.
Erwan Brugalle, mathématicienmathématicien, actif dans le réseau de recherche européen RAAG (Real Algebraic & Analytic Geometry), préfère parler de "vocation inconsciente". "J'ai toujours fait des maths pour le plaisir, pour la beauté que je pouvais y trouver. Après plusieurs années d'études, j'avais donc une formation en maths pures qui ne m'offrait aucun débouché à part l'enseignement et la recherche. Aimant les maths pour les maths, j'ai préféré la recherche. En plus, on proposait de me payer pour me consacrer à mon art..."
- Thésards inégaux.
"Payer". Mais souvent si mal... Côté finances, quelques pays semblent néanmoins des "paradis de recherche" pour ceux qui s'y lancent. En Norvège, tous les doctorants bénéficient d'un subside de leur université ou d'une bourse pendant ces quelques années. En Irlande, les thésards sont considérés comme des étudiants, reçoivent des aides du gouvernement ou sont sponsorisés par des entreprises. L'argent est rarement un frein. "Un PhD prend trois ou quatre ans. Je considère cela comme un travail, c'est tout, estime Frances Coughlan, en dernière année de doctorat en ingénierie à l'Université de Limerick. Un travail que j'effectue de 8h à 17h, du lundi au vendredi, et pour lequel je touche un chèque à la fin du mois. Le danger, si l'on considère trop la recherche comme une vocation, est qu'on se laisse tellement submerger par son travail de thèse qu'on n'arrive jamais à le terminer à temps."

Mais tous les doctorants ne bénéficient pas de ce type de confort. En France, ceux qui optent, par exemple, pour la recherche médicale devront effectuer au moins huit années d'études ; un quart d'entre eux recevront un financement public (peu ou prou comparable au "minimum d'existence" légal) tandis que les autres devront se "débrouiller".
Et puis, la thèse n'est qu'une première étape. Pour Norbert Babcsan, ingénieur-docteur hongrois en physique et secrétaire général de l'association PINet (Postgraduate International Network), "un doctorat devrait prouver, en principe, que quelqu'un est capable de mener un travail scientifique seul. Mais cet idéal théorique est loin de se vérifier. Faire une thèse revient souvent à se former sous la direction d'un professeur qui vous implique dans un projet dont il mène lui-même la barque. Aussi, dans l'ancien système d'Europe centrale, existait un diplôme dit de candidat chercheur qui ne s'obtenait qu'à l'âge de 40 ans, alors qu'un doctorat, dans le concept classique admis internationalement, se décroche en général au début de la trentaine."
- La chaîne des post-doctorats
La thèse n'est donc souvent qu'un premier pas. "Mais si on n'a pas la vocation de chercheur, une thèse est tout à fait suffisante dans l'industrie, où on préfère des gens plus jeunes", fait remarquer Florian Berberich, physicien allemand en post-doctorat à Grenoble. Ceux qui se destinent à la recherche savent, par contre, que le « post-doc » devient incontournable. Ils savent aussi que la concurrence est vaste et l'avenir flou. Les universités ont peu de ressources et offrent peu d'horizons en termes de travail quelque peu stable, de perspectives de carrière, de salaire. Rami Olavi Vainio, qui vit en Finlande, pays pourtant particulièrement dynamique en matière de recherche, le constate dans son domaine : l'espace. "En physique, en astrophysiqueastrophysique, et surtout en astronomie, il n'existe qu'une poignée de postes permanents pour l'ensemble du pays. Ces postes sont détenus par les chercheurs seniors et les professeurs. Dans le même temps, des centaines de jeunes doctorants et post-doctorants vivent de bourses et de contrats temporaires. C'est à ce stade que la compétition est la plus dure. Même s'il faut admettre qu'elle constitue un stimulant pour l'excellence, la compétition finit par éliminer du circuit scientifique des jeunes très capables, qui passent à des jobs aux conditions plus confortables dans le secteur privé."
Les post-doctorats s'enchaînent donc souvent les uns aux autres. Si les bourses nationales permettent de poursuivre dans la même institution, les bourses européennes ne sont généralement données que pour deux ans. La plupart des chercheurs nomadisent. "La recherche est une passion. Elle peut procurer autant de satisfaction que de détresse", dit Claire Foullon, spécialiste en physique solaire et astronomie. Une passion qui vous vole bien du temps. "On n'arrête pas de travailler, ou en tout cas de penser. On vit en permanence avec ses questions. Parfois il me vient une idée en faisant du roller ou en nageant" (Florian Berberich).
- Stimuli et dérives.
Sport et recherche. Dénominateur commun : la compétition. La concurrence, en effet, les chercheurs connaissent. Ils en acceptent les règles et ne la voient pas toujours d'un mauvais oeil. "Nous devons vivre avec la compétition. Elle permet de sélectionner les meilleurs" (Norbert Babcsan). "Un peu de compétition, c'est sain. Ca pousse les gens à mieux travailler" (Marco Albani, post-doctorant à l'université de Harvard).
Nuances, cependant. Si la concurrence entre laboratoires et universités est un stimulus positif, les "batailles" entre pairs peuvent entraîner des effets pervers. "L'esprit d'équipe doit être plus important que la quête de gloire et de reconnaissance", estime Véronique Boisvert, physicienne canadienne, post-doctorante au CERN (CH) après avoir réalisé un doctorat à la Cornell University (USA).
Mais l'esprit d'équipe dépend sans doute aussi des "chefs de corps" et du "stylestyle maison". Janette Friedrich, philosophe allemande (ex-RDA), aujourd'hui maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève, voit évoluer la compétition au fil des ans. "J'ai ressenti peu de concurrence lors de concours pour l'obtention de bourses, ou au cours des séjours financés de cette manière, car les chercheurs fonctionnent alors comme des individus hors institution. Mais depuis que je suis engagée à l'Université, je ressens vivement la concurrence sous forme de méfiance (par rapport à la conception de la recherche de l'autre), de non-reconnaissance (d'un autre point de vue théorique) et d'un manque d'ouverture d'esprit et de respect. J'ai l'impression que cette concurrence s'amplifie car la lutte de ma génération autour des quelques postes de professeurs a commencé."
Tout au contraire, Claire Foullon, qui a travaillé dans des universités écossaises (Glasgow et St-Andrews) et belge (K.U.Leuven), n'a souffert d'aucune pesanteur dans ces milieux. "J'ai ensuite quitté le monde académique pour entrer à l'Observatoire Royal de Belgique. Si j'ai ressenti une concurrence et une relation maître-élève, qui me paraissaient quasi absentes auparavant, c'est bien dans cet institut de recherche public. Les responsables de projets orchestrent la compétition à l'intérieur du groupe et détiennent les commandes de toute collaboration vers l'extérieur. La rentabilité est aussi pesante que dans le secteur privé, ce qui crée une atmosphèreatmosphère peu sereine et peu propice à la recherche."

- Course aux fonds.
L'argent, nerfnerf de la guerre, comme partout, est exacerbé par sa rareté. "L'objectif d'atteindre 3% du PIBPIB de l'Union en dépenses de recherche d'ici 2010 est très ambitieux. Malheureusement certains pays (comme la France) prennent des mesures qui vont dans le sens inverse. C'est dramatique, car de nombreuses études démontrent clairement la corrélation entre activité de recherche et croissance d'un pays", souligne le français Alexandre Urani, responsable d'un projet de recherche à l'Institut central de santé mentale de Mannheim (DE) et membre du bureau de l'association Eurodoc.
"J'ai pris d'autant plus conscience des problèmes de financement pour la recherche publique que je venais du secteur privé", souligne Michèle Gué, enseignante-chercheuse à l'Université de Montpellier II (FR). Lorsque vous souhaitez obtenir des fonds pour démarrer une nouvelle thématique, par exemple, il faut présenter des publications faisant référence à des résultats. Mais, puisqu'on débute, on n'a pas encore publié. C'est la quadrature du cercle..."
En outre, l'adage est connu. Publier ou périr. La course aux fonds exacerbe la course à l'édition qui demeure, bien sûr, un principe clé de l'avancement des connaissances mais qui, sous la pressionpression, peut dévier de son but et favoriser le "superficiel". "On doit pouvoir résister à cette pression. Il le faut si on ne veut pas renoncer à la qualité", estime Janette Friedrich.
- Liberté chérie.
L'argent et la liberté peuvent-ils faire bon ménage? "Je crois que le vrai poids que ressentent les chercheurs dans mon domaine provient principalement des comités de subventions plus que de l'université ou du laboratoire, estime Véronique Boisvert, du CERN. Une recherche se fera si ces comités la jugent digne d'obtenir des fonds. Heureusement, il me semble cependant qu'il y a assez de latitudelatitude à l'intérieur de ces soutiens pour être capable d'orienter le projet dans la direction souhaitée par les chercheurs."
Quand on demande à Pablo Achard, également au CERN, quel est le poids d'un institut sur ses chercheurs, il répond par une énigme de physicien : "Est-ce qu'un électronélectron crée un champ électromagnétiquechamp électromagnétique en se déplaçant ou est-ce que le champ influence la trajectoire de l'électron? Les deux à la fois. On s'insère dans une ou des équipes dont les priorités de recherches et les moyens sont déterminés par des évaluateurs. Mais on peut également participer à ces choix et les influencer."
Alors, la liberté de recherche est-elle réelle, relative, utopique? Réponse de philosophe. "Cela dépend de ce qu'on comprend par liberté, remarque Janette Friedrich. S'il s'agit d'un concept minimal qui laisse une liberté de choix de l'objet de la recherche et de son traitement, elle me semble respectée. Si on privilégie le concept positif qui inclut la reconnaissance de la différence dans la recherche et l'assurance des conditions pour mener tous les types et courants de la recherche, elle n'est pas vraiment réalisée