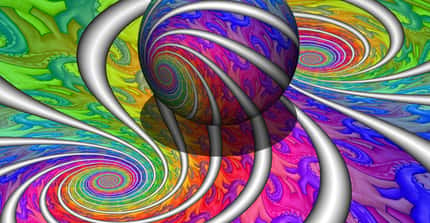au sommaire
- Causes de la guerre de Cent Ans
- À lire aussi sur Futura :
- 1337 : début de la guerre de Cent Ans
- Bataille de Crécy et conquête de l'Aquitaine
- 1380 : mort de Charles V
- La reconquête française
- Guerre civile entre Bourguignons et Armagnacs
- 1415 : la bataille d'Azincourt et ses conséquences
- La bataille d'Azincourt : importante défaite des Français face aux Anglais
- L'alliance des Bourguignons et des Anglais
- 1429 : arrivée de Jeanne d'Arc et reprise d’Orléans
- L'arrivée de Jeanne d'Arc
- Le dauphin est sacré à Reims
- 1453 : fin de la guerre de Cent Ans
- Conséquences de la guerre de Cent Ans
- À lire aussi
La guerre de Cent Ans représente un tournant dans l'histoire de France. Retour sur ce conflit qui dura de 1337 à 1453. Voyons ici les causes profondes de cette guerre.

En réalité il n'y eut pas vraiment « une » guerre de Cent Ans, mais plutôt une série de conflits étalés sur plus d'un siècle entre dirigeants issus de deux familles puissantes rivales :
- les Capétiens, rois de France ;
- les Plantagenêts, rois d'Angleterre.
Avant la guerre de Cent Ans, les vieux royaumes de France et d'Angleterre semblaient avoir jusqu'alors une relation plutôt harmonieuse. Richard Cœur de LionLion (1157-1199) et Philippe Auguste (1165-1223) avaient combattu côte à côte aux croisades. La dynastie des Plantagenêts découlait des ducs de Normandie qui, au XIe siècle, avaient établi le royaume d'Angleterre moderne en vainquant les rois saxons à la bataille d'Hastings, en 1066.
Causes de la guerre de Cent Ans
Mais c'est justement cette parenté qui va rapidement poser problème : les rois d'Angleterre sont toujours, en théorie, ducs de Normandie. Ainsi, d'un côté, le roi de France supporte mal qu'un roi étranger possède l'un de ses plus grands fiefs et, de l'autre côté, le roi d'Angleterre est humilié d'être le vassal d'un autre roi.

Dans ce dossier, nous verrons que cette question va agiter les deux familles et provoquer une première série de conflits quand Philippe Auguste chasse le successeur de Richard Cœur de Lion, le roi anglais Jean sans Terre, de ses possessions françaises. Après la bataille de Bouvines (1214), Philippe Auguste ne laisse grosso modo au roi d'Angleterre qu'un petit territoire en Gascogne. Mais les Plantagenêts auront leur revanche...
À lire aussi sur Futura :
- Les ducs de Bourgogne et leur histoire
- Quels furent les plus grands rois capéciens ?
- Pourquoi y avait-il la peste au Moyen Âge ?
1337 : début de la guerre de Cent Ans
1337 marque le début de la guerre de Cent Ans. Comment les royaumes de France et d'Angleterre en sont-ils arrivés là ? Retour sur les origines de cette guerre ainsi que sur ses débuts.

En 1223, le roi de France Philippe Auguste décède. Ses fils puis les successeurs de Philippe IV le Bel (les « rois maudits ») se déchirent pour la couronne et déclenchent une crise de succession.
À la mort du roi Charles IV le Bel, en 1328, les Capétiens directs ont disparu. Deux candidats sont alors possibles : son cousin, Philippe de Valois, ou son neveu, Édouard III, roi d'Angleterre. C'est Philippe de Valois qui accède au trône, devenant Philippe VI de Valois, roi de France.
Le conflit aquitain est rouvert et atteint son paroxysme en 1337 : Philippe VI de Valois décide, par mesure de rétorsion, de confisquer la Guyenne (sud-ouest de la France) à Édouard III, roi d'Angleterre. Celui-ci réplique en revendiquant la couronne de France. C'est le début de la guerre de Cent Ans.
Bataille de Crécy et conquête de l'Aquitaine
Dans un premier temps, les Anglais rencontrent de très nets succès. Ils écrasent l'armée française à la bataille de Crécy (1346), prennent la ville de Calais (1347) et conquièrent l'Aquitaine (1356). Les Anglais sont généralement plus unifiés que les fiefs français et l'on cite également la qualité de leurs archers (qui utilisent la technologie du longbow) pour expliquer leur supériorité au combat. Français et Anglais se battent également pour la Bretagne, dont le titre de duc est lui aussi en proie à une guerre de succession : chacun des deux camps a son favori pour accéder à la tête du duché.

Jean II le Bon succède à Philippe VI en 1350. Le nouveau roi de France est capturé en 1356 lors de la bataille de Poitiers (à l'issue de la chevauchée dévastatrice menée par le Prince Noir, fils d'Édouard III). Sa libération contre une rançon très élevée pousse les Français à accepter une première trêve.
1380 : mort de Charles V
En 1360 est signé le traité de Brétigny et, avec lui, la paix, qui durera neuf ans. En 1369, la guerre reprend sur ordre du roi de France Charles V. C'est la reconquête française. Mais en 1380, Charles V meurt et son successeur, Charles VI, est atteint de folie. La guerre civile entre Bourguignons et Armagnacs éclate peu après. Retour sur ces évènements.

La paix signée à Brétigny en 1360 donne à Édouard III une grande portion de l'ouest de la France, mais l'exclut lui-même du trône. Cependant, le nouveau roi de France, Charles V, ne fait pas confiance à son rival et considère que le traité n'est qu'une trêve.
La reconquête française
En 1369, la guerre reprend sur ordre du roi de France Charles V. C'est la reconquête française. Bien que la guerre de succession de Bretagne ait vu la victoire du candidat anglais, celui-ci ne tarde pas à se réconcilier avec le roi de France et devient un allié important. Le général breton Bertrand du Guesclin joue ainsi un rôle prépondérant dans les succès de l'armée de Charles V.
Édouard III est trop vieux pour faire la guerre et ses généraux les plus puissants dont son fils, le Prince Noir, meurent au combat ou sont capturés. Bientôt, des troubles internes en Angleterre (révolte du pays de Galles, conflits avec l'Écosse) et l'accession au trône du fragile Richard II poussent les Anglais à accepter une paix beaucoup plus favorable aux Français.

Guerre civile entre Bourguignons et Armagnacs
Mais le royaume de France ne tarde pas à rencontrer lui aussi des problèmes internes. Charles V décède en 1380 et son successeur, Charles VI, est atteint de folie. Deux personnages ambitieux en profitent pour prendre le contrôle du royaume de France : son frère Louis d'Orléans et le puissant duc de Bourgogne Jean sans Peur. Les deux hommes s'affrontent pour obtenir l'ascendant sur Charles VI : c'est la « querelle des Armagnacs et des Bourguignons ». Dans ce contexte, la France évite de chercher le conflit avec l'Angleterre.

Mais quand les Anglais eux-mêmes retrouvent leur stabilité sous le règne d'Henri V, ils trouvent la situation propice pour attaquer une France déchirée. C'est le début de la phase la plus célèbre du conflit...
1415 : la bataille d'Azincourt et ses conséquences
Henri V, roi d'Angleterre, débarque avec son armée en 1415 en Normandie. La même année, sur le site d'Azincourt, il rencontre une armée française beaucoup plus puissante. Mais, à la surprise générale, Henri V écrase littéralement les Français. Quelles sont les conséquences de cette défaite ?

La bataille d'Azincourt : importante défaite des Français face aux Anglais
Après la défaite d'Azincourt (1415), la France se trouve pratiquement sans défense et Henri V circule librement entre Caen et Calais : un vaste territoire autour de la Normandie passe entre les mains anglaises.
L'alliance des Bourguignons et des Anglais
Pour couronner le tout, le puissant duché de Bourgogne saisit l'occasion de s'allier aux Anglais. Rêvant de devenir un royaume indépendant à son tour, la Bourgogne ne fait rien pour aider son suzerain le roi de France. Bien au contraire, tout ce qui peut affaiblir la couronne française est bon pour les projets d'indépendance des ducs de Bourgogne. En 1420, la Bourgogne et les Anglais envahissent Paris et le roi Charles VI doit accepter le mariage d'Henri V avec sa fille. En outre, son propre fils, le dauphin, est exclu de la succession : le roi anglais Henri V vient d'obtenir que ses enfants soient les futurs rois de France.
Le dauphin, réfugié dans le centre de la France, n'accepte pas cette décision et décide de continuer la lutte contre les Anglais et les Bourguignons. Les anciens membres du parti des Armagnacs le soutiennent et une armée écossaise vient également à son secours. Alors que les Anglais assiègent la ville d'Orléans, un personnage particulier va venir au secours du dauphin...
1429 : arrivée de Jeanne d'Arc et reprise d’Orléans
L'histoire de Jeanne d'Arc est bien connue : ayant reçu ce qu'elle appelle un message divin, elle quitte son village pour rencontrer le dauphin et le persuader de mener son armée à la victoire.

L'arrivée de Jeanne d'Arc
Au moment où Jeanne arrive devant le dauphin en 1429, les Anglais ont déjà cessé leur avance : à Orléans, ils ont assez de forces pour assiéger la ville, mais pas assez pour l'envahir ni continuer plus loin sur le territoire français.
L'armée française est déjà renforcée et proche de la ville, mais le moral est bas. Pour l'essentiel, l'arrivée de Jeanne d'Arc représente un retour à l'esprit offensif : Orléans est reprise. L'armée française sécurise ensuite la Loire en reprenant la plupart des ponts et, surtout, vainc les troupes anglaises de John Talbot à Patay. Cette défaite, la première des longbows (archers) anglais, est un tournant car désormais la route de Reims est libre. Or, c'est à Reims que le dauphin doit être sacré pour devenir roi de France.
Le dauphin est sacré à Reims
Accompagné de Jeanne d'Arc, dont la popularité va grandissante, Charles traverse le territoire occupé par les Anglais et les Bourguignons et gagne la cathédrale de Reims, où il devient le roi Charles VII le 17 juillet 1429. Cependant, peu de temps après, Jeanne d'Arc est capturée par les troupes bourguignonnes qui tenaient encore les environs de la ville. Livrée aux Anglais, elle est jugée pour hérésie et brûlée en place publique à Rouen.

Essentiellement symbolique, Jeanne d'Arc continue à jouer un rôle important après sa mort. Mais son importance sur le champ de bataille ne doit pas être exagérée. Le principal succès de Charles VII est diplomatique : en 1435, il parvient à convaincre le duc de Bourgogne d'abandonner l'alliance anglaise pour, au contraire, soutenir la France. Paris est rendue aux Français en échange de gains territoriaux aux Bourguignons.
1453 : fin de la guerre de Cent Ans
La guerre de Cent Ans s'achève en 1453. Cette année est celle de la bataille de Castillon, qui voit la victoire décisive des Français sur les Anglais. Retour sur ces évènements et sur les conséquences de la guerre de Cent Ans.

Le roi de France Charles VII est à l'origine d'une armée permanente et centralisée qui échappe à la vieille tradition féodale. À la tête de ses troupes, il reprend Rouen en 1449 et, bien vite, après la bataille de Formigny (1450), Caen repasse du côté français. Au final, seule Calais reste anglaise. La guerre de Cent Ans se termine en 1453 lors de la bataille de Castillon, qui voit la victoire décisive des Français sur les Anglais.
Conséquences de la guerre de Cent Ans
La guerre de Cent Ans a des conséquences terribles pour les deux pays. La population française aurait diminué de moitié pendant le conflit, la peste ayant sévi à cette époque étant plus dévastatrice que la guerre.
En Angleterre, la dynastie des Plantagenêts est fragilisée et l'armée anglaise démobilisée cherche le conflit. C'est l'origine d'une guerre civile anglaise entre les deux branches des Plantagenêts que sont les York et les Lancastre : ce sera la guerre des Deux-Roses.
On considère par ailleurs que la guerre a donné le jour à des sentiments nationaux très forts qui n'existaient pas auparavant. Le risque de disparition du royaume de France fut bien réel pendant un temps et les Anglais craignaient que les Français ne débarquent sur leur île. Ce qui commença comme une dispute entre deux rois pour une seule couronne devint la lutte de deux peuples pour leur survie.

Après la guerre de Cent Ans, la France se concentra sur le continent et l'Angleterre sur les îles britanniques. Par conséquent, les deux pays bataillèrent moins souvent. Les Anglais allaient toutefois connaître plusieurs guerres civiles pour affronter Écossais et Irlandais. Quant à la France, elle allait s'opposer aux véritables vainqueurs de la guerre de Cent Ans : les puissants ducs de Bourgogne.