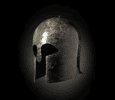au sommaire

Vins de 0 à 12 ° d'alcool
«L'expérimentation pour le vin des techniques de désalcoolisation » fait partie du plan d'action présenté fin mars 2006 par le Ministère de l'AgricultureAgriculture aux professionnels pour relancer le secteur viti-vinicole français. On observe en effet une désaffection des consommateurs vis-à-vis des teneurs en alcool élevées qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs : changement de mode de vie et de travail, notamment sédentarisation, respect du code de la route, raisons de santé.
Le vin sans alcool
Un vin sans alcool, cela peut sembler antinomique. En effet, l'appellation « vin » sensu stricto est réservée aux produits titrant au moins 8 ou 9° d'alcool, suivant les cépages et les régions.
Et pourtant, un produit sans alcool, proche de la composition du vin, est commercialisé depuis 15 ans en 3 couleurs : rouge, rosé et blanc, par l'Union des caves coopératives de l'ouest audois et du Razès, sous licence INRA. Plus d'un million de bouteilles sont vendues chaque année dans les rayons des grandes surfaces en France et à l'étranger. Ce produit appelé « Bonne nouvelle » contient environ 0,2 % en volume d'alcool et de 4 à 8 fois moins de caloriescalories qu'un vin traditionnel. Pourtant, il conserve la composition initiale du vin en polyphénolspolyphénols : anthocyanes, catéchinescatéchines, proanthocyanes(ou taninstanins condensés).
D'une part, l'alcool est le deuxième constituant en volume après l'eau et il est difficile de l'extraire sans entraîner d'autres composés, en particulier les arômes. Plus on va loin dans la désalcoolisation, plus les composés entraînés sont nombreux. Le procédé de désalcoolisation utilisé pour le vin sans alcool permet de limiter la perte de ces précieux composants. Il consiste à évaporer l'alcool du vin en l'absence de tout phénomène d'oxydation lors d'une distillation sous vide partiel à basse température (40°C). Des procédés d'osmoseosmose inverse sont aussi à l'étude.
D'autre part, l'alcool a un rôle essentiel dans la perception sensorielle du vin. Il tempère la sensation d'acidité, rehausse la note sucrée et contribue au moelleux en bouche. Sans alcool, le vin est perçu plus acideacide et plus astringentastringent. Pour éviter l'acidité liée à l'absence d'alcool, le procédé « Bonne nouvelle » utilise des cépages riches en anthocyanes qui ont un pouvoir tampon. Pour atténuer l'astringence liée aux tannins, on peut rajouter du glycérolglycérol à celui qui est naturellement produit dans le vin par la fermentationfermentation (de 6 à 8 g par litre). La législation autorise l'ajout de glycérol jusqu'à une teneur totale de 15 g par litre. On ajoute aussi, en faible proportion (10 à 20 g/l), du sucresucre par l'intermédiaire de moût de raisinraisin et des arômes de vins pour apporter du moelleux à la boisson.
Vers l'élargissement de la gamme des vins à teneur réduite en alcool
Le vin sans alcool est un produit de diversification de la vigne qui répond à la demande du marché. La maîtrise de l'élaboration de cette boisson fortement désalcoolisée permet d'envisager la maîtrise de l'ensemble de la gamme entre 0 et 12 % d'alcool. La diffusiondiffusion d'une telle gamme ouvrirait de fortes perspectives de développement pour les professionnels du vin.
L'INRA de Montpellier coordonne en ce sens depuis le premier janvier 2006 un programme de recherche. Ce programme, impliquant pendant 3 ans 12 partenaires publics et privés, intègre des travaux à caractères biotechniques, sensoriels et socio-économiques.
L'approche biotechnique concerne la sélection de variétés de vignes produisant des raisins moins riches en sucre et celles de levureslevures à plus faible taux de conversion des sucres en alcool. Elle concerne aussi la mise au point de procédés de désalcoolisation partielle en début de fermentation, qui permettent de réduire la teneur finale en alcool, sans trop perturber la production des arômes fermentaires.
L'approche sensorielle développée essentiellement à l'INRA de Dijon consiste à quantifier l'impact de la quantité d'alcool sur les propriétés organoleptiquesorganoleptiques du vin : acidité, astringence, etc.
Les études socio-économiques visent d'une part à identifier, dans différents pays, les types de consommateurs émergentsémergents en lien avec les contextes de consommation et d'autre part à préciser l'acceptabilité de nouveaux produits à teneur réduite en alcool et à déterminer leur place sur le marché.