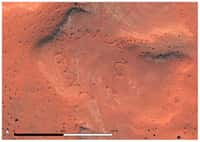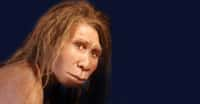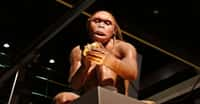Le monde dans lequel nous vivons et le degré technologique que nous avons atteint résultent de notre capacité en tant que société à implémenter la connaissance sur la base des acquis des générations précédentes. C’est ce que l’on appelle la culture cumulative. L’analyse des outils en pierre taillée a permis de montrer que cette capacité exceptionnelle de l’être humain serait apparue clairement il y a 600 000 ans.
au sommaire
C'est un fait, si nous devions réinventer l'eau chaude à chaque génération, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Nous bâtissons en effet les nouvelles technologies sur une base de connaissances qui a été implémentée au fil du temps, de génération en génération. Sur des milliers d'années, le savoir a ainsi été transmis, permettant aux jeunes générations d'aller chaque fois un peu plus loin.
Car le savoir n'est pas inné. Il résulte d'un tâtonnement progressif, parfois d'un coup de chance, souvent d'un nombre important de boucles « essais-erreurs ». Les Hommes n'ont pas réussi à fabriquer de l'acier du jour au lendemain. Températures de chauffe, constructionsconstructions de fours, maîtrise des proportions de fer et de carbone... Combien de temps avant que le bon procédé ne soit enfin établi ? Et l'on se rend compte de l'incroyable quantité de prérequis qui a été nécessaire pour aboutir à la métallurgie du fer. Celle-ci devenant alors le piédestal pour le développement d'autres alliages, toujours plus complexes.

La capacité de s’adapter rapidement à de nouvelles situations
Cette culture cumulative est l'une des grandes capacités de l'Homme. Par la transmission d'un savoir diffusé au sein d'une société, elle a ainsi permis le développement d'une technologie extrêmement complexe, qu'un seul individu ne pourrait jamais inventer de façon indépendante sur le court laps de temps de sa vie. La culture cumulative a permis aux Hommes de la Préhistoire de s'adapter à des conditions d'habitats très diverses, parfois hostiles et d'y prospérer. Aujourd'hui, le niveau de savoir est tel que nous sommes totalement dépendants de cette culture cumulative. Mais depuis quand cette dépendance existe-t-elle ?
Caractériser l’évolution des techniques de taille du silex
Depuis quelle époque de la Préhistoire nos ancêtres ont-ils commencé à bâtir leur savoir systématiquement sur celui des générations précédentes ? Une nouvelle étude publiée dans la revue Pnas révèle que cette culture cumulative pourrait bien s'être instaurée il y a 600 000 ans.
Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques de l'université d'État d'Arizona ont analysé l'évolution de la complexité des procédés de taille de la pierre sur 3,3 millions d'années. Cette notion de complexité a été mesurée à partir d'une base où l'on considère qu'il n'existe pas de culture cumulative. Les chercheurs ont ainsi comparé les techniques de taille utilisées par nos ancêtres de la Préhistoire à celles des primatesprimates non-humains comme les chimpanzéschimpanzés, et à celles de personnes inexpérimentées dans la taille des silex. La complexité des techniques a ensuite été caractérisée par le nombre d'étapes ou de procédures mises en œuvre à partir de cette base.

Pas de culture cumulative avant 1,8 million d’années
Les résultats montrent ainsi qu'entre 3,3 et 1,8 millions d'années, la fabrication des outils en pierre est restée proche du niveau de base, n'impliquant que de une à six étapes de fabrication. La simplicité des techniques et leur non-évolution au cours du temps révèlent qu'il n'y avait alors pas de culture cumulative au sein de ces groupes d’hominines, dont faisaient partie AustralopithèqueAustralopithèque et les premiers représentants du genre HomoHomo. En gros, chaque génération repartait du début, sans réussir à tirer profit des expérimentations réalisées par les générations précédentes.
Une complexification bien marquée à partir de 600 000 ans
Les choses commencent à changer entre 1,8 million d'années et 600 000 ans, où le niveau de complexité augmente. Le nombre d'étapes est ainsi de quatre à sept. Mais c'est à partir de 600 000 ans que les choses vont s'accélérer de façon très marquée. Les outils en pierre révèlent ainsi la mise en œuvre de nombreuses étapes, jusqu'à 18, signe d'une complexification qui résulte de l'introduction d'une culture cumulative. La fabrication d’outils dans le but de se nourrir est d'ailleurs très certainement à l'origine de cette capacité à intégrer et à implémenterimplémenter le savoir précédemment acquis. La culture cumulative va alors impacter tous les aspects de la vie dans les sociétés du genre Homo qui cohabitent alors à cette époque : maîtrise du feu, organisation des espaces domestiques, techniques de chasse, travail du boisbois et de l'os...

Si l'on regarde le monde animal, on pourrait ainsi penser que la culture cumulative est le propre de l'Homme. Pourtant, de précédentes études ont montré que ce n'était pas le cas. Les babouins et les chimpanzés seraient en effet également capables d’améliorer les connaissances transmises de génération en génération, mais de manière excessivement simple. Seule l'Humanité semble avoir poussé cette capacité à l'extrême.