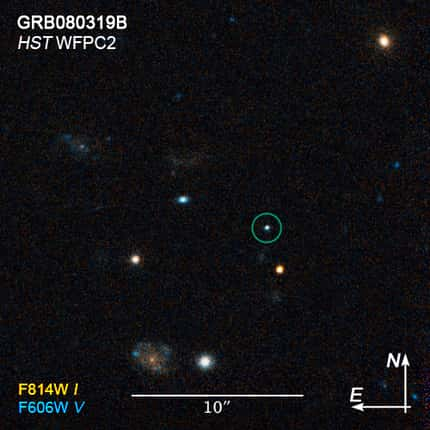Pendant quelques heures, l’étoile naine rouge EV Lacerta a émis une bouffée d’énergie énorme. Son éclat était tel que certains instruments en ont été momentanément aveuglés. Ce jeune astre est coutumier du fait mais ce feu d'artifice a dépassé tous les autres.
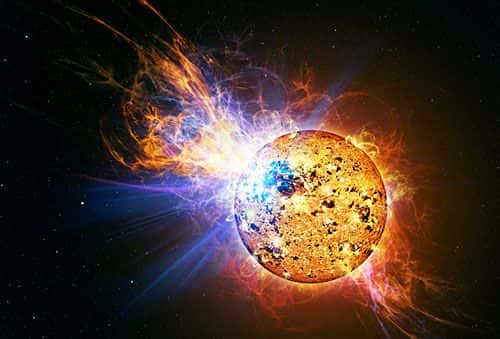
Flare stellaire (vue d'artiste). Crédit Nasa
Dans la matinée du 25 avril dernier, l'instrument russe Konus, installé à bord du satellite Wind de la Nasa, a détecté une puissante émission en rayons X provenant de la constellation du Lézard (Lacerta). Alerté par ses propres détecteurs, le satellite astronomique Swift a aussitôt pivoté pour se diriger vers la petite étoile EV Lacerta. Lorsqu'il a tenté d'observer l'émission deux minutes plus tard dans les domaines optique et ultravioletultraviolet, l'émission était tellement intense que les appareils se sont arrêtés d'eux-mêmes pour des raisons de sécurité.

Le satellite Swift. Crédit Nasa
L'étoile appartient à la catégorie des naines rougesnaines rouges, de loin la plus répandue dans l'UniversUnivers. Sa distance n'est que de 16 années-lumièreannées-lumière mais sa taille et son éclat, qui représentent respectivement le tiers et le centième de ceux de notre SoleilSoleil, ne nous permettent pas de l'apercevoir à l'œilœil nu. De dixième magnitudemagnitude seulement, son observation n'est possible qu'au moyen d'instruments relativement puissants.
Selon Rachel Osten, de l'université du Maryland, EV Lacerta est coutumière de ce genre d'émissions, que les astronomesastronomes appellent des flares. Il s'agit cependant de la plus lumineuse jamais observée et de tels phénomènes à répétition suffiraient pour souffler l'atmosphèreatmosphère de planètes à proximité, les rendant stériles en peu de temps.
Une étoile d'humeur instable
Agée d'une centaine de millions d'années seulement, EV Lacerta tourne sur elle-même en quatre jours, beaucoup plus rapidement que notre Soleil qui met 26 jours pour effectuer un tour complet (au niveau de l'équateuréquateur). Ce faisant, elle génère de très puissants champs magnétiqueschamps magnétiques localisés, une centaine de fois plus intenses que celui produit par le Soleil. L'énergieénergie s'accumule à l'intérieur de ces champs et, périodiquement, se libère en provoquant des flares.
La constellation du Lézard n'est observable que quelques heures seulement au printemps dans l'hémisphère nordhémisphère nord. Si elle s'était trouvée plus haut dans le ciel, EV Lacerta aurait probablement été visible à l'œil nu durant quelques heures après son émission...
EV Lacerta, étant environ 15 fois plus jeune que notre Soleil, ouvre une fenêtrefenêtre permettant aux astronomes d'observer ce que devait être notre propre Système solaireSystème solaire à ses débuts. La vitesse de rotationvitesse de rotation des très jeunes étoiles est très rapide, ce qui provoque l'émission de telles bouffées d'énergie. Le Soleil est certainement passé par cette phase durant son premier milliard d'années d'existence, ce qui a considérablement dû affecter la surface des planètes en formation qui l'entouraient alors.
Ces flares libèrent de colossales quantités d'énergie dans tout le spectrespectre électromagnétique, mais les températures extrêmement élevées des gazgaz éjectés ne les rend observables qu'au moyen d'instruments à haute énergie comme ceux montés sur SwiftSwift. Ses détecteurs à champ large et ses capacités de réorientation rapide, conçus initialement pour l'étude des GRB (Gamma Ray BurstBurst) en font l'instrument idéal pour observer les flares stellaires.