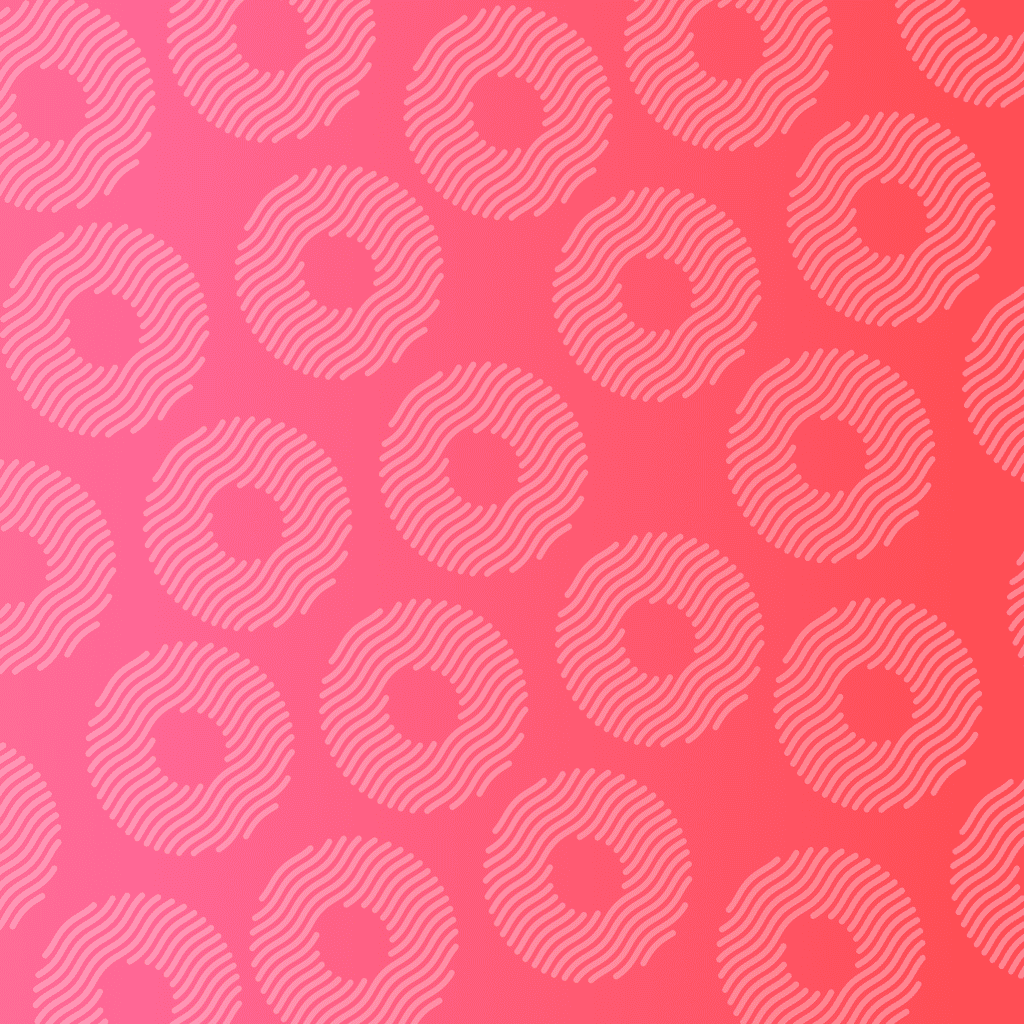Zoom sur quelques actions ou projets financés par l'AFMAFM
1 : Essai préclinique de thérapie génique réussi sur le rat
Dans les années 1950, deux Américains - les docteurs Crigler et Najjar - découvrent une maladie à laquelle ils donnent leur nom : la maladie de Crigler-Najjar. Cette maladie monogénique se manifeste dès les premières heures de vie. Elle est causée par la déficience d'une enzyme du foiefoie qui empêche l'élimination de la bilirubinebilirubine, substance toxique pour l'organisme. Il s'agit en fait d'une jaunissejaunisse congénitale qui se prolonge toute la vie.
Cette jaunisse « sans fin » peut entraîner, chez les enfants concernés, des atteintes neurologiques, cérébrales et neuromusculaires. Elle met en jeu leur pronosticpronostic vital du fait de la toxicitétoxicité de la bilirubine. Cette maladie raremaladie rare touche une naissance sur un million. En France, on compte une vingtaine de personnes atteintes. Le seul traitement préventif à disposition aujourd'hui, la photothérapiephotothérapie, oblige les enfants à rester minimum 12 à 16 heures par jour sous des lampes à lumière bleue. Ces patients sont suivis pour la plupart par le Pr. Philippe Labrune dans le service de PédiatriePédiatrie de l'Hôpital Antoine Béclère, à Clamart. La maladie de Crigler-Najjar apparaît comme une maladie modèle pour la thérapie géniquethérapie génique : un seul gènegène en cause et un seul organe concerné, le foie.
En août 2005, l'équipe de Nicolas Ferry (biothérapies en hépatogastroentérologie - EE 0502 CICCIC-Inserm4, CHU de Nantes) a ainsi publié les résultats concluants d'un essai de thérapie génique sur un modèle animal naturel de cette maladie, le rat Gunn.
Les chercheurs ont injecté dans le sang de rats malades âgés de deux jours des vecteurs viraux portant le gène codant l'enzyme manquante (appelée bilirubine uridinediphosphate glucuronosyltransférase). Six semaines après, les concentrations de birilubine sont apparues normales. La correction est encore effective 1 an et demi après. Les chercheurs s'attachent aujourd'hui à améliorer le vecteur utilisé et à le tester sur de plus gros animaux. Ces travaux ouvrent ainsi la voie à une application clinique pour la maladie de Crigler-Najjar.
Ils permettent également de tirer des enseignements sur le transfert de gène dans le foie, enseignements utiles pour toutes les pathologiespathologies hépatiques.