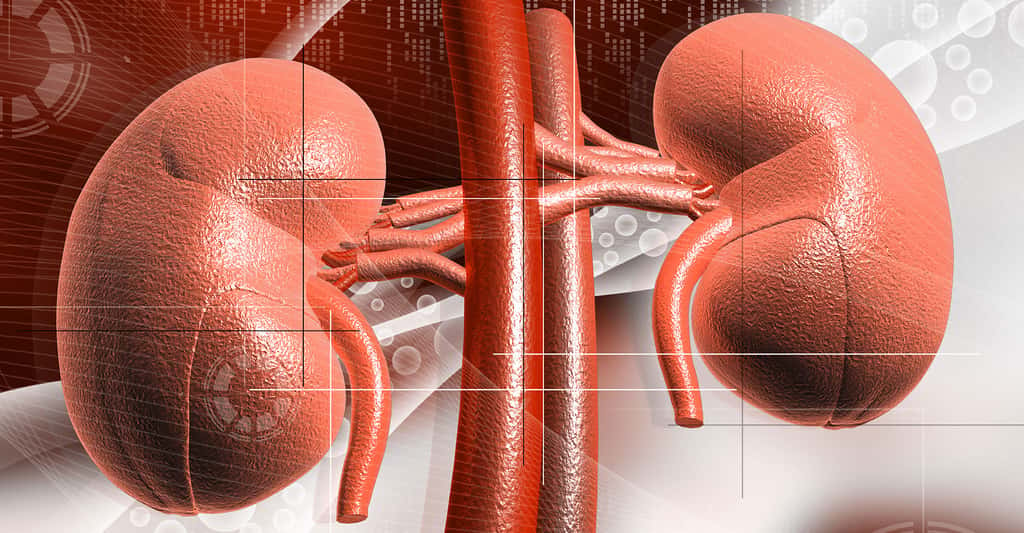au sommaire
Le diagnosticdiagnostic de l'incontinence fécale permet de mettre en place des traitements appropriés, par chirurgiechirurgie ou non.

Diagnostic de l'incontinence fécale : les examens
- L'anamnèseanamnèse : cet examen recherche éventuellement s'il existe des antécédents chez le patient, l'hérédité, il mesure la fréquence et la survenue des symptômessymptômes. Le médecin retrace l'historique médical du sujet et des traitements qu'il aurait déjà pris et comprendre les succès et échecs pour adapter au mieux et préciser un diagnostic clair en se basant sur ces premiers éléments. Le médecin regroupe tous les facteurs qui ont conduit le patient à déclencher une incontinence anale (saignements dans les selles ou pas, aspects (diarrhéediarrhée ou constipationconstipation), présence d'un prolapsus.
- L'examen clinique : avec toucher rectaltoucher rectal en décubitus latéral gauche ou position gynécologique, c'est-à-dire le corps allongé et les pieds fixés sur les étriers. Ce toucher permet d'avoir une idée sur la tonicité des muscles périnéaux, sphinctériens et de détecter un fécalome.
- L'imagerie médicale : elle intervient si lors des deux premiers examens, rien n'a été trouvé. L'imagerie consiste en une échographieéchographie endoanale qui par l'introduction d'une sonde, après un lavement évacuateur, permet d'observer l'état des sphincters (par exemple l'existence de ruptures) et si la paroi anale n'est pas trop abîmée. Par ailleurs, les médecins peuvent demander au patient de procéder à une défécographie qui est un examen radiologique qui met en évidence les anomaliesanomalies pelviennes. Il consiste à l'injection d'un produit baryté (produit de contrastecontraste à base de sulfate de baryum) qui permet d'approcher au mieux la solidité de la matière fécale et d'observer où se situe la rétention et de mesurer la gravité de l'incontinence anale.
- La manométrie anorectale précise le système d'écoulement, de fonctionnalité des muscles sphinctériens et permet de vérifier la sensibilité du rectumrectum. Elle est préconisée en cas de constipation terminale chronique.
- Enfin, l'électromyogramme périnéal. Utile en préopération chirurgicale, il explore les voies nerveuses du périnéepérinée grâce à des électrodes placées sur la zone à évaluer.
Les traitements de l’incontinence fécale
Outre l'adoption des règles hygiénodiététiques, une thérapiethérapie médicamenteuse peut être proposée au patient pour réguler le transit intestinaltransit intestinal, efficace selon la tolérance de chacun. Un article publié en 2005 par OlivierOlivier Touchais, du CHU de Rouen, indique qu'« un trouble du transit intestinal associé à l'incontinence anale doit être systématiquement recherché et traité, avant de réévaluer l'incontinence et d'entreprendre éventuellement un traitement spécifique de celle-ci ». De plus, en cas de constipation qui entraîne un fécalome, il peut être administré au patient un laxatif via les suppositoires de glycérineglycérine ainsi que des lavements évacuateurs. À contrario, en cas de diarrhée, des ralentisseurs de transit feront effet grâce à l'atropine (alcaloïdealcaloïde inhibiteur) ou de la cholestyramine (résine aux propriétés séquestrantes).
De plus, une rééducation périnéale peut faire partie du traitement. Elle implique entièrement le patient, il devient véritablement acteur dans ses soins. Le renforcement des muscles appuie au niveau du périnée et du sphincter anal externe.
D'autre part, le biofeedback et l'électrostimulation, qui favorisent l'amélioration en cas d'incontinence urinaire, peuvent aussi être appliqués pour l'incontinence anale car ils optimisent la retenue. Il en est de même pour le toucher rectal, bon pour la contraction musculaire volontaire.
La chirurgie peut s'avérer indispensable et concluante selon les cas et la gravité d'incontinence anale.
La neuromodulation : utilisée depuis 1998, cette méthode consiste à implanterimplanter une électrode dans un des orifices du sacrumsacrum (os reliant cinq vertèbres) pour stimuler électriquement les nerfsnerfs et redonner aux patients le contrôle volontaire pour se rendre aux toilettes. Cette technique est biphasée. Dans un premier temps, il s'agit d'effectuer un test de stimulationstimulation afin de savoir si le sujet malade répond aux stimuli. La seconde phase la pose permanente de ce système. La neuromodulation fonctionne pour les cas d'incontinence anale par impériosité.
D'autre part, en cas de prolapsus rectal extériorisé, une rectopexie peut être envisagée, après discussion, par le corps médical. Réalisée par laroscopie, la rectopexie vise à modifier une anomalie anatomique.
Enfin, en cas d'incontinence sévère, le dernier recours chirurgical consiste à poser un sphincter anal artificiel. Mais ces cas sont rares. Il s'agit de placer autour du canal anal, une manchette fabriquée en siliconesilicone, un réservoir de liquideliquide et une pompe dans le système sphinctérien. Un jeu de remplissage de la manchette comprime le canal. Ainsi, lorsque le patient désire se rendre aux toilettes, il n'a plus qu'à appuyer sur la pompe qui déclenche automatiquement l'ouverture du rectum grâce à la vidange de la manchette.