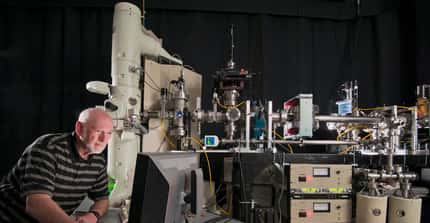La réglisse apaiserait la toux. ©. F. Le Driant / FloreAlpes.com
Appartenant à la famille des fabacées, la réglisse est originaire d'Europe méridionale et d'Orient. Ses racines, connues pour l'arôme si particulier qui est le leur, contiennent des flavonoïdes, des tanins, des saponines. Autant de substances qui confèrent à la réglisse ses nombreuses vertus... et ses inconvénients.
En réalité la réglisse est la racine d'une plante vivace d'environ 1m de haut, qui porteporte de petites fleurs violacées. Au bout de trois ans, les racines doivent être déterrées, pelées et séchées à une température maximale de 35 °C. Elles sont ensuite hachées pour être utilisées en infusion, ou moulues pour entrer dans la composition de remèdes phytothérapeutiques. En les faisant bouillir avec de l'eau, on obtient de l'extrait de réglisse dont on fait des pastilles au goût sucré.
La réglisse soulagerait la toux
Les racines sont utilisées pour traiter divers troubles digestifs : ballonnements épigastriques, digestion lente, renvois, flatulences. La réglisse serait également efficace contre la toux sèche, et les douleursdouleurs liées aux affections de la bouche et du pharynxpharynx.
Elle sert comme adjuvantadjuvant dans le traitement de l'ulcère gastrique ou de la gastritegastrite. Par ailleurs, la réglisse augmenterait la duréedurée de vie d'hormoneshormones telles que la cortisonecortisone et le cortisolcortisol, sécrétées par la partie externe des glandes surrénalesglandes surrénales.
Elle exerce hélas un effet identique sur l'aldostéronealdostérone, l'hormone qui favorise la rétention d'eaurétention d'eau et de sodiumsodium et empêche la fixation du potassiumpotassium. C'est pourquoi à hautes doses, la réglisse est toxique en particulier en cas d'insuffisance cardiaqueinsuffisance cardiaque et hépatique. Pour cette même raison, les friandises à la réglisse sont vivement déconseillées aux personnes hypertendues.
Source : Plantes médicinalesPlantes médicinales, Gründ
Phytothérapie
Note. La phytothérapie est utilisée en médecine traditionnelle depuis des siècles. Son efficacité et son innocuité restent toujours discutées. Et pour cause, comme l’explique l’Organisation mondiale de la Santé dans un rapport de 1998, « un nombre relativement petit d'espèces de plantes ont été étudiées pour d’éventuelles applications médicales ». Cet article s’inscrit naturellement dans cette démarche. Ajoutons que compte tenu des risques éventuels d’effets indésirables, d’interactions médicamenteuses voire de toxicité de certaines plantes, informez toujours votre médecin, si vous recourez régulièrement à la phytothérapie.
Bibliographie :
- Guide des plantes qui soignent, édition Vidal, 2010.
- L'Encyclopédie des plantes médicinales, édition Larousse, 2001 et 2017.
- Les plantes médicinales, Institut européen des substances végétales, mars 2015.
- Ma bible des huiles essentielles, Danièle Festy, éditions Leduc.s, 2017.
- Les huiles essentielles chémotypées, Dominique Baudoux et M.L. Breda, édition JMO.