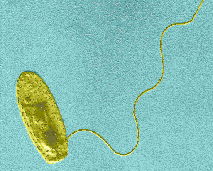au sommaire

Les conduites de climatisation sont un environnement propice à la multiplication des bactéries responsables de la légionellose. © John Pozadzi, Flickr, CC by-nc-sa 2.0
La légionellose est une forme de pneumopathie grave et parfois mortelle. Elle est provoquée par une bactérie, Legionella pneumophilaLegionella pneumophila, et parfois par d'autres espècesespèces de légionelles.
Agent de la légionellose
Legionella pneumophila est une bactérie qui vit naturellement dans l'environnement et prolifère dans les eaux tièdes et les endroits tièdes et humides. Elle est fréquente dans les lacs, les rivières, les ruisseaux, les sources chaudessources chaudes et divers autres gîtes aquatiques. Elle s'observe également dans le sol et dans le terreau de rempotage.
Transmission de la légionellose
Legionella pneumophila a été identifiée pour la première fois en 1977 : c'est cette bactérie qui a provoqué une flambée de pneumopathies graves dans le centre où s'est réunie une convention, aux États-Unis en 1976. Depuis, elle a été associée à diverses flambées reliées à des systèmes aquifèresaquifères artificiels mal entretenus, notamment aux tours aéroréfrigérantes ou aux aérocondenseurs employés pour la climatisationclimatisation dans les climatiseurs et les systèmes de refroidissement industriels, aux réseaux de distribution d'eau chaude et froide dans des bâtiments publics et privés, et aux bains bouillonnants.
Après inhalation des aérosolsaérosols, les bactéries présentes sont absorbées au niveau des alvéoles pulmonaires puis elles envahissent les macrophages, cellules du système immunitairesystème immunitaire, qu'elles finissent par détruire.
La quantité de légionelles nécessaires pour provoquer une infection est inconnue, mais la dose infectieuse pourrait être faible pour des personnes sensibles, car on connaît des cas d'infection après exposition de quelques minutes seulement à la source de certaines flambées et d'autres situés jusqu'à 3,2 kilomètres de la source. La survenue de l'infection dépend de plusieurs facteurs : degré de contaminationcontamination de l'eau, efficacité de la formation d'aérosols et de la dissémination de la bactérie par voie aérienne, facteurs d'hôte et virulence de la souche de légionelle en cause.
Symptômes de la légionellose
Légionellose est un terme générique appliqué aux formes pulmonaires et non pulmonaires d'infection par Legionella.
La forme non pulmonaire est une affection aiguë, à guérisonguérison spontanée, de type grippal, d'une duréedurée de deux à cinq jours. L'incubation va de quelques heures à 48 heures. Les symptômessymptômes majeurs sont la fièvrefièvre, les frissons, les céphaléescéphalées, la dégradation de l'état général et les douleursdouleurs musculaires (myalgies). Aucun décès n'est associé à ce type d'infection.
La légionellose pulmonaire a une durée d'incubation de deux à dix jours (mais qui peut atteindre 16 jours, comme on l'a observé lors de flambées récentes bien documentées). Initialement, les symptômes sont la fièvre, la perte d'appétit, les céphalées, la dégradation générale et la léthargie. Certains patients présentent également des douleurs musculaires, des diarrhéesdiarrhées et une confusion. À ce tableau s'ajoute généralement une toux initiale bénigne, productive chez un nombre de patients qui peut atteindre 50 %. Chez environ un tiers des patients, on observe des crachats contenant du sang ou une hémoptysiehémoptysie. La gravitégravité de la maladie est variable, de la toux bénigne à la pneumopathie rapidement fatale. Le décès est dû à la pneumopathie évolutive accompagnée d'une insuffisance respiratoireinsuffisance respiratoire ou d'un choc et d'une défaillance multiviscérale.
Non traitée, cette forme s'aggrave en général pendant la première semaine. Comme pour les autres pneumopathies sévères, les complications les plus fréquentes de la légionellose sont :
- l'insuffisance respiratoire ;
- le choc ;
- l'insuffisance rénaleinsuffisance rénale aiguë ;
- la défaillance multiviscérale.
Traitement de la légionellose
La guérison nécessite un traitement antibiotiqueantibiotique et après plusieurs semaines, voire plusieurs mois, elle est en général complète. Il s'ensuit parfois une pneumopathie évolutive, un échec du traitement de la pneumopathie et, rarement, des séquellesséquelles cérébrales.
Le taux de mortalité par légionellose est fonction de la gravité de la maladie, de l'adéquation du traitement antimicrobien initial, des conditions dans lesquelles Legionella a provoqué l'infection et des facteurs de l'hôte (la maladie est en général plus grave chez les immunodéprimés). Le taux de létalité peut atteindre 40 à 80 % chez les patients immunodéprimés non traités, et peut être ramené à 5 à 30 % quand la prise en charge est appropriée, suivant la gravité des signes et des symptômes cliniques. Le taux de mortalité se situe en général dans la fourchette 10 à 15 % chez les personnes capables d'élaborer une réponse immunitaire.