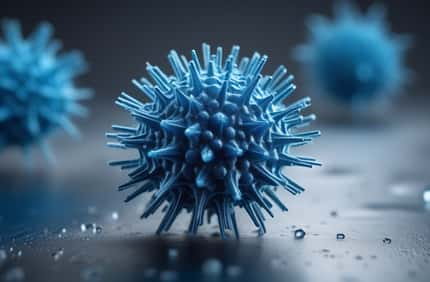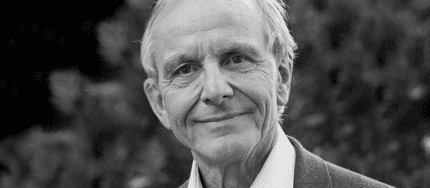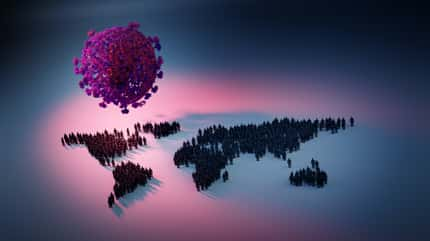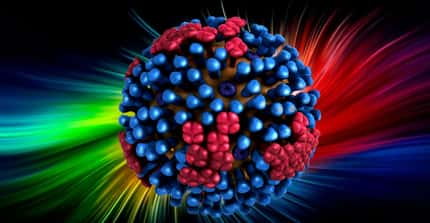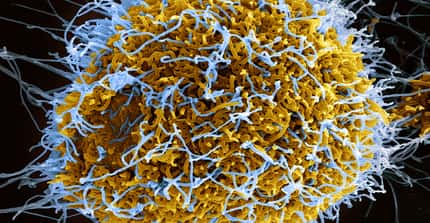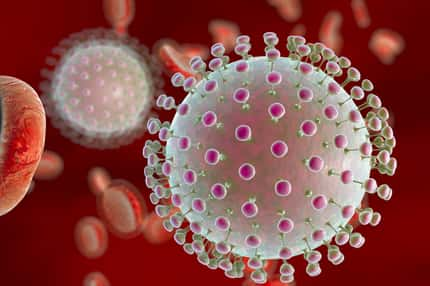Entre le coronavirus qui n’en finit pas de se propager dans le monde et le virus de l’hépatite C remis sur le devant de la scène par le comité Nobel, les virus font la Une. Et aujourd’hui, c’est le virus de la rubéole qui est mis à l’honneur par des chercheurs qui viennent de lui trouver de proches parents.
au sommaire
En pleine pandémie de Covid-19 et alors que les découvreurs du virus de l'hépatite C viennent tout juste d'être récompensés par le prix Nobel de physiologie et de médecine, des chercheurs annoncent avoir mis la main sur deux parents inconnus d'un autre virus, celui de la rubéole. Depuis son identification en 1962, il était resté le seul représentant de la famille des Matonaviridea.
Rappelons que le virus de la rubéole est un virus aéroporté quasiment éradiqué grâce à un vaccin efficace. Dans les quelques endroits où il subsiste, il peut provoquer des éruptions cutanées et des symptômessymptômes pseudo-grippaux. Il est le plus dangereux pendant la grossessegrossesse car il peut provoquer une fausse couchefausse couche, une mortinaissance ou des anomaliesanomalies de développement du fœtusfœtus. Jusqu'à 100.000 enfants naissent ainsi chaque année sourds, aveugles ou avec des problèmes cardiaques.
Cette fois, c'est chez des mammifèresmammifères, et en deux endroits très différents du globe, que deux des parents du virus de la rubéole ont cette fois été isolés. Chez des chauves-sourischauves-souris en Ouganda, et chez des animaux de zoo en Allemagne. Et jusqu'à la moitié des animaux testés étaient porteurs. Laissant penser que les deux espècesespèces peuvent agir comme des réservoirs viraux, transportant et transmettant des agents pathogènespathogènes sans tomber malades.

Pas de transmission aux Hommes… pour l’instant
L'équipe qui étudiait les chauves-souris en Ouganda cherchait en réalité des coronaviruscoronavirus. C'est donc un peu par hasard que le virus -- que les chercheurs ont baptisé ruhugu, du nom de l'endroit où il a été trouvé -- leur est apparu dans des analyses génétiquesgénétiques. Un virus très semblable à celui de la rubéole, sauf pour une région clé de son génomegénome. Une région qui lui permet de se lier aux cellules d'hôtes.
L'autre équipe cherchait à identifier la cause de la mort d'un âne, d'un kangouroukangourou arboricolearboricole de Bennett et d'un capybaracapybara dans un zoo allemand. C'est ainsi que les chercheurs ont découvert rustrela -- du nom du détroit de Strela, situé à proximité --, une variante du virus de la rubéole qui semble un peu plus éloignée que ruhugu.
Pour en apprendre plus sur ces deux virus -- notamment s'ils peuvent être contenus par le même vaccinvaccin que celui de la rubéole --, les chercheurs vont devoir mener une étude plus approfondie en laboratoire. Ce qu'ils savent, c'est que pour l'heure, ces nouveaux virus ne semblent pas en mesure d'infecter des humains. Mais le doute existe, notamment parce que rustrela a été retrouvé dans plusieurs espèces très différentes. Et s'il était capable de se propager aux Hommes, cela pourrait remettre en question l'éradication de la rubéole.

De l’importance de préserver les écosystèmes
La découverte devrait aider à mieux connaître le virus de la rubéole également. Car s'il n'existe pas de bons modèles animaux pour le sonder, rustrela offre une nouvelle opportunité de se pencher sur la famille des Matonaviridae par le biais de souris de laboratoiresouris de laboratoire.
Ces travaux montrent par ailleurs une fois de plus l'importance des efforts de conservation des forêts pour contrer l'empiètement des activités humaines. Car protéger les habitats naturels des animaux sauvages est aussi crucial pour eux que pour les Hommes. « Lorsque les écosystèmesécosystèmes restent intacts, les virus restent à leur place », concluent les chercheurs.