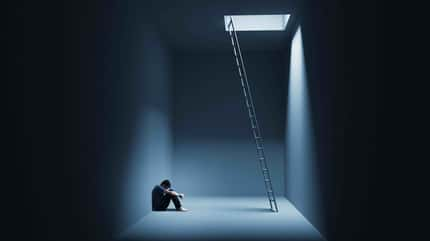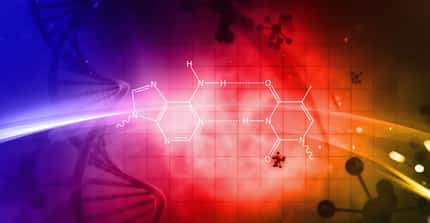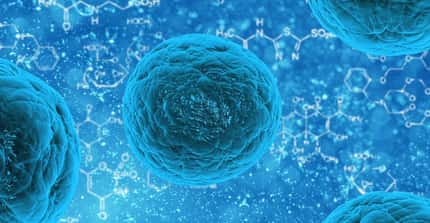Réparer ou modifier l'ADN pour traiter des maladies considérées comme incurables n’est plus une promesse futuriste. Grâce aux thérapies géniques, c'est déjà une réalité pour de nombreux patients. On parle d’ADN ou d’ARN médicament, capable de reprogrammer les cellules. Voici tout ce que vous devez savoir sur les thérapies géniques d’aujourd’hui en cinq questions clés.
au sommaire
- Question n° 1 : Est-ce que la thérapie génique soigne uniquement les maladies génétiques ?
- Question n° 2 : Quels sont les chiffres clés des thérapies géniques en France et en Europe, en 2025 ?
- Question n° 3 : Les modifications génétiques induites sont-elles durables ?
- Question n° 4 : Quels sont les différents types de thérapies géniques aujourd’hui ?
- Question n° 5 : À quoi devra ressembler l'hôpital de demain pour accueillir la thérapie génique ?
- Conclusion
- À lire aussi
Découvrez les aspects essentiels de la thérapie génique en 2025 : maladies soignées, chiffres clés, impacts et bien plus en cinq questions.
Question n° 1 : Est-ce que la thérapie génique soigne uniquement les maladies génétiques ?
La recherche autour des thérapies géniques envisage de pouvoir soigner prochainement :
- des maladies chroniques, comme le diabète ou l’insuffisance cardiaque ;
- des troubles neurologiques, comme Parkinson ou Alzheimer ;
- ou encore des infections graves, comme le VIH.
Question n° 2 : Quels sont les chiffres clés des thérapies géniques en France et en Europe, en 2025 ?
Quatorze thérapies géniques sont déjà autorisées en Europe ; 3 463 patients ont été traités par thérapie génique en France en 2024.
Parmi ces thérapies en cours de développement, 28 sont déjà en phase 3, une phase d’essais comparatifs visant à évaluer l'efficacité du nouveau traitement par rapport à un traitement standard sur un large échantillon de patients.
On estime que 69 400 patients pourraient être traités en 2030. Les coûts des thérapies géniques sont actuellement compris entre 290 000 et 3 500 000 dollars.

Question n° 3 : Les modifications génétiques induites sont-elles durables ?
Pour que le nouveau matériel génétique puisse pénétrer les cellules cibles, il faut un vecteur, une sorte de moyen de transport, qui peut être un virus inactivé, des liposomes (petites « bulles » graisseuses qui protègent le gène), ou des cellules du patient génétiquement modifiées.
C’est ce vecteur qui détermine si le nouveau matériel génétique modifie durablement le patrimoine génétique. La plupart des vecteurs sont non intégratifs : le matériel génétique qu’ils transportent reste dans le noyau de la cellule sans s’intégrer à son ADN.
Toutefois, pour soigner des maladies affectant des cellules qui se multiplient très rapidement (comme les cellules sanguines), on utilise des vecteurs intégratifs, afin que la correction génétique soit conservée au fil des divisions cellulaires.
Mais, même dans ce cas, la modification génétique ne pourra pas être transmise à une éventuelle descendance. Il faudrait pour cela modifier génétiquement les cellules germinales (cellules sexuelles pouvant donner des ovules ou des spermatozoïdes). Or la thérapie génique germinale est aujourd’hui interdite en France.
Question n° 4 : Quels sont les différents types de thérapies géniques aujourd’hui ?
Il existe aujourd’hui deux voies principales pour administrer une thérapie génique.
- Les thérapies géniques in vivo : le matériel génétique fonctionnel est directement injecté dans l’organisme du patient. Cette méthode peut utiliser différentes approches, comme l’injection d’ADN nu, l’utilisation de liposomes ou encore des vecteurs viraux pour acheminer le gène cible dans les cellules.
- Les thérapies géniques ex vivo : les cellules du patient sont prélevées, modifiées génétiquement en laboratoire, puis réintroduites dans l’organisme. Cette méthode est notamment utilisée dans les traitements par cellules CAR-T (Chimeric Antigenic Receptor - T), des cellules immunitaires reprogrammées dans le but de reconnaître puis éliminer les cellules cancéreuses.
Question n° 5 : À quoi devra ressembler l'hôpital de demain pour accueillir la thérapie génique ?
Les infrastructures hospitalières doivent anticiper un accroissement très important du nombre de patients traités par thérapie génique. Cela signifie notamment des équipements spécialisés et des personnels soignants formés, pour administrer ces traitements sous surveillance et pouvoir prendre en charge d’éventuels effets cliniques non attendus.
Par ailleurs, la fabrication des vecteurs génétiques exige des laboratoires hautement spécialisés et sécurisés.
Enfin, c’est toute une logistique associant l’industrie pharmaceutique et l’hôpital qui doit être repensée. En effet, les médicaments issus de la thérapie génique sont extrêmement fragiles et nécessitent des conditions de stockage et de transport à des températures allant de -80 °C à -196 °C.
Conclusion
Les thérapies géniques représentent aujourd’hui une perspective de traitement pour un nombre croissant de patients. Il s’agit dès à présent d’anticiper leur arrivée.
Article rédigé en partenariat avec le LEEM