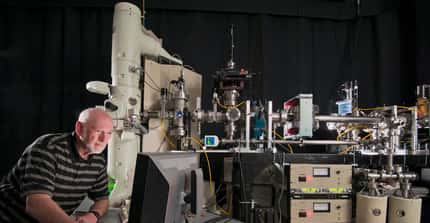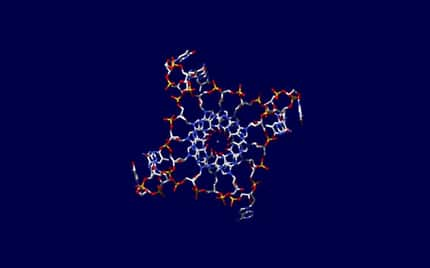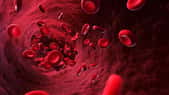La concentration atmosphérique de dioxyde de carbonedioxyde de carbone, ou CO2, ne cesse d'augmenter malgré les efforts réalisés pour en limiter les émissionsémissions. Aujourd'hui, la teneur atmosphérique en CO2 est de 389 parties par million (ppmppm), soit 0,039 %. Selon les estimations les plus extrêmes, ce chiffre pourrait atteindre les 1.000 ppm (0,1 %) en 2100.
Si les effets du réchauffement de la planète sont assez prévisibles, on ignore les effets directs d'un tel accroissement de la concentration de ce gazgaz sur les êtres vivants. Les scientifiques connaissent les effets néfastes du CO2 sur les cellules mais uniquement à des concentrations bien plus élevées.

La pollution, due à l'activité humaine, entraînera-t-elle une augmentation des maladies liées à la toxicité de l'oxygène ? © Shi Yali, Stockvault.net
Escherichia coliEscherichia coli n'aime pas trop le CO2
Ainsi, entre 1 % et 10 %, le CO2 a des conséquences sur les réactions biochimiques cellulaires, menant notamment à une augmentation du stress oxydatif, une inflammation pulmonaire chez la souris et à l'augmentation de la virulence de certaines bactéries pathogènes. Pour connaître les effets du CO2 à une concentration dix fois moins élevée, similaire à celle qui s'annonce pour le siècle prochain, une étude a été réalisée par une équipe de recherche du CNRS basée à l'Institut de microbiologie de la Méditerranée à Marseille et menée par Sam Dukan.
Ils ont appliqué sur la bactérie modèle Escherichia coli différentes concentrations de l'airair en CO2 (entre 40 et 1.000 ppm, soit entre 0,004 et 0,1 %). Cultivées en milieu liquideliquide, les bactéries semblent ne pas avoir beaucoup apprécié les quantités les plus élevées en CO2. En effet, le nombre de colonies obtenues après l'étalement d'une dilution de la suspension bactérienne sur une boîte de Pétri, qui représente le nombre de bactéries vivantes dans la culture liquide, diminue proportionnellement à la quantité de CO2 dans l'air. Toutefois, cette toxicité ne s'observe qu'en présence d'un second facteur : le peroxyde d'hydrogèneperoxyde d'hydrogène, ou eau oxygénée (H2O2), un dérivé réactif de l’oxygène (ROS).
Les ROS sont connus pour altérer, par oxydationoxydation, les macromoléculesmacromolécules cellulaires, notamment en créant des mutations dans l'ADNADN, ce qui peut provoquer l'apparition de cancers. Or il avait été montré in vitroin vitro que les ROS réagissaient aussi avec les deux formes issues du CO2 dissout dans l'eau (les ionsions carbonate CO32- et bicarbonatebicarbonate HCO3-), et forment notamment le radical carbonate (CO3•-) qui est aussi une moléculemolécule réactive. Cette fois-ci, les chercheurs ont amené la preuve que la réaction est la même in vivoin vivo, dans la cellule.
Des oxydations préférentielles
Ainsi, les scientifiques ont constaté que l'augmentation de CO2 entraîne non seulement une augmentation de la mort cellulaire, mais aussi une augmentation de la fréquence des mutations de l'ADN, lorsque des ROS sont présents. Mais à l'inverse des ROS qui s'attaquent à toute sorte de macromolécule, le CO3•- possède des cibles privilégiées, comme la modification de la guanineguanine en 8-oxo-guanine (plutôt qu'une action sur les trois autres bases de l'ADN).
Ces résultats, publiés dans la revue EMBO reports, démontrent que l'augmentation de la quantité atmosphérique de CO2 est potentiellement dangereuse pour tous les organismes vivants, qui seront alors plus sensibles aux effets néfastes de l'oxygène. Les chercheurs veulent maintenant tenter de corréler la survenue de maladies liées au stress oxydatif chez la souris et la concentration atmosphérique en CO2.