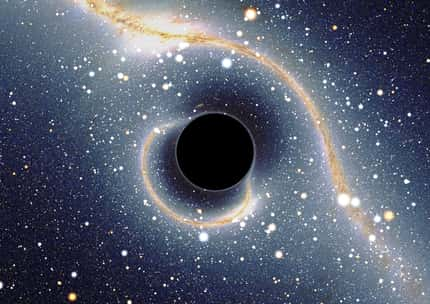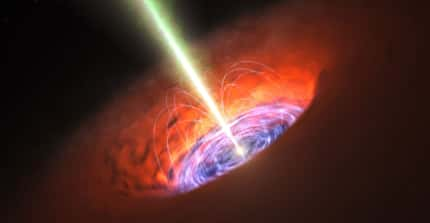Ce 14 mars 2018, Stephen HawkingStephen Hawking s'en est allé à 76 ans pour d'autres universunivers. Le célèbre astrophysicien, grand vulgarisateur d'une discipline pourtant complexe, était touché depuis l'âge de 21 ans par la maladie de Charcot. Lorsqu'il a été diagnostiqué il y a plus de cinquante ans, Stephen Hawking ne s'imaginait probablement pas vivre aussi longtemps.
La maladie de Charcot, ou sclérose latérale amyotrophiquesclérose latérale amyotrophique (SLASLA), touche environ une personne sur 25.000. En France, 800 personnes sont diagnostiquées pour cette maladie chaque année, d'après Orphanet. La SLA touche plus les hommes que les femmes, et souvent des sportifs. Aux États-Unis, elle est appelée « maladie de Lou Gehrig », du nom d'un célèbre joueur de baseball décédé en 1941. Le tennisman Jérôme Golmard, ancien numéro un du tennis français, était lui aussi atteint par la maladie de Charcot ; il est décédé l'an passé à l'âge de 43 ans.
Bien que ces patients célèbres aient été atteints jeunes par la pathologie, la maladie de Charcot apparaît plutôt entre 50 et 70 ans. Elle est due à la dégénérescence de neurones, des motoneurones, les cellules nerveuses qui envoient des messages aux muscles pour commander les mouvementsmouvements. Il ne faut pas confondre la SLA avec la maladie de Charcot-Marie-Tooth.
Le saviez-vous ?
Jean-Martin Charcot (1825-1893), qui a décrit la maladie portant son nom, est parfois considéré comme le fondateur de la neurologie moderne. Il est aussi connu pour ses travaux sur l’hystérie.
Le film Augustine sorti en 2012 évoque une relation fictive entre ce médecin, joué par Vincent Lindon, et une de ses patientes.
La destruction des motoneurones conduit à l'affaiblissement des muscles, qui deviennent inactifs et s'atrophient. Les muscles des bras, des jambes, de la respiration sont touchés. Progressivement, le patient ne peut plus accomplir certaines fonctions essentielles : marcher, déplacer ses bras, parler, déglutir... Pour s'exprimer, Stephen Hawking utilisait un ordinateur. Grâce à un curseur qui se déplaçait sur un clavierclavier virtuel, il pouvait choisir une lettre par une contraction de sa joue.

Jean-Martin Charcot était un illustre médecin du XIXe siècle qui exerçait à la Pitié-Salpêtrière. © DP
Une longévité remarquable malgré cette maladie neurodégénérative
Les causes de la SLA ne sont pas bien connues, plusieurs facteurs pouvant intervenir : anomalies liées au glutamateglutamate (un messager du cerveau), dérèglement d'un facteur de croissancefacteur de croissance, inflammationinflammation, dégénérescence des mitochondriesmitochondries, anomalies de l'apoptoseapoptose, hérédité... Les formes familiales sont rares ; elles se déclarent souvent plus tôt et peuvent être dues à une mutation du gènegène SOD1.
Il existe un médicament qui ralentit la maladie, le riluzole, en diminuant le taux de glutamate dans le cerveau. En raison des difficultés respiratoires, une assistance pour la ventilationventilation doit être envisagée. Parfois, une trachéotomie est réalisée pour insérer un tube relié à un respirateur. Les fonctions intellectuelles sont préservées.
La maladie évolue à une vitessevitesse variable en fonction des patients, mais, en moyenne, après le diagnosticdiagnostic, l'espérance de vieespérance de vie est de trois à cinq ans ; 10 % des patients vivent plus de dix ans après le diagnostic. Le décès est souvent dû aux problèmes respiratoires ou à des infections liées aux problèmes de déglutition.
“Aussi difficile que la vie puisse paraître, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir.”
Stephen Hawking, en vivant bien plus longtemps que les quelques années qui lui étaient données lors de son diagnostic, est la démonstration qu'une maladie évolue différemment en fonction des individus mais aussi que chaque patient est un cas unique qui peut déjouer les statistiques. La façon dont il évoquait et surmontait sa maladie est aussi une source d'espoir et une leçon de vie pour beaucoup d'entre nous : « Mes attentes ont été réduites à zéro quand j'avais 21 ans. Depuis, tout a été un bonus ». Mais encore : « Aussi difficile que la vie puisse paraître, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir ».
Ce qu’il faut
retenir
- Stephen Hawking a été diagnostiqué pour la maladie de Charcot à l'âge de 21 ans.
- Cette pathologie conduit à une dégénérescence des motoneurones et à une atrophie des muscles, y compris de ceux servant à parler, déglutir et respirer.
- Stephen Hawking est décédé le 14 mars 2018 à l'âge de 76 ans.