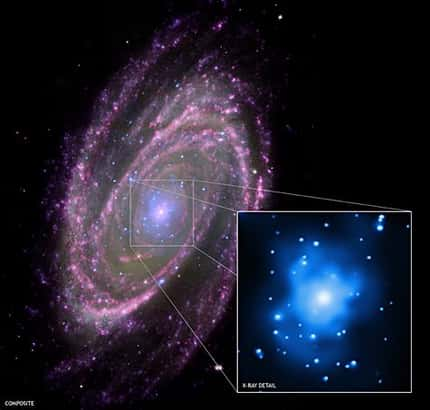au sommaire
Certaines fourmisfourmis ont un régime alimentaire fixe, d'autres utilisent la symbiose avec les cochenillescochenilles ou les puceronspucerons pour obtenir le miellatmiellat dont elles se nourrissent.

Les différentes espèces de fourmis n'ont pas le même régime alimentaire. Ici, Formica rufa. © Adam Opiola Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license
Régime alimentaire des fourmis rousses des bois
Les fourmis rousses des boisbois du genre Formica ont un régime alimentaire mixte. Comme les fourmis prédatrices, elles font une grande consommation de proies animales. Toutes sortes d'arthropodesarthropodes leur conviennent : araignéesaraignées, chenilles, diptères, punaises... sont activement chassés et capturés. Les carapaces dures des coléoptèrescoléoptères ne résistent pas à la force de leurs mandibulesmandibules. Le butin est d'autant plus impressionnant que certaines fourmis rousses des bois réalisent de véritables mégapoles en fédérant leurs dômes.
La supercolonie qui nidifie dans le Jura vaudois regroupe environ 1.200 nids peuplés de 200 millions d'individus occupant un domaine de 70 hectares. Les pistes chimiques qui relient tous ces dômes ont un développement total de plus de 100 km. Toutes les ouvrières s'identifient comme faisant partie de la même société car elles partagent les mêmes phéromonesphéromones de reconnaissance évoquées dans les pages précédentes. Leur cuticulecuticule est porteuse d'hydrocarbures spécifiques qui autorisent leur passage d'un nid à l'autre. Cette gigantesque force de frappe peut ainsi récolter annuellement 400 millions de proies. Leur impact est particulièrement spectaculaire lors de l'attaque des forêts par des défoliateurs. On remarque l'existence d'îlots de verdure autour des nids alors que le reste de la forêt est ravagé. Le rôle hygiéniste est reconnu puisque les fourmis rousses des bois font l'objet de mesures de protection.
Les ressources en protéinesprotéines ne constituent que 35 % de leur menu. Les matières sucrées représentent l'essentiel de leur alimentation. Les fourmis rousses exploitent le miellat produit par les pucerons des épicéas. En réponse à des caresses antennaires, les pucerons émettent par l'anusanus des gouttelettes sucrées qui représentent l'excès de sève qu'ils prélèvent à l'aide de leurs pièces buccales piqueuses-suceuses.

L’association pucerons-fourmis constitue une symbiose mutualiste. Chaque partenaire y trouve avantage : le miellat produit par les pucerons pour les fourmis et la protection offerte par les fourmis pour les pucerons. © D. Cherix
Les quantités de miellat recueillies sont impressionnantes puisque les ouvrières se livrent nuit et jour à la collecte et véhiculent une quantité de jus sucré équivalent au ¾ de leur masse. On a calculé que la récolte quotidienne de miellat est de l'ordre de 120 à 170 g par jour. Au total, un dôme de taille moyenne récupère annuellement une vingtaine de kilogrammes de ce délicieux liquide. Les pucerons apprécient la visite des fourmis qui d'une part leur évite de s'engluer dans leurs propres excréments et d'autre part chassent par leurs allers et venues les minuscules guêpes parasitesparasites pondant dans leur corps. Les colonies de pucerons sont bien plus prospères quand elles sont fréquentées par des fourmis. Au total chacun y trouve son compte : les fourmis par l'accès à une source de nourriture, les pucerons par une protection efficace. C'est un parfait exemple de symbiose mutualiste.
Régime alimentaire des fourmis granivores ou moissonneuses
Ajoutons que les fourmis des bois récoltent aussi des graines pour compléter un régime alimentaire varié. C'est un apport limité puisqu'il ne constitue que 4 % de leur collecte. Pour d'autres espècesespèces, les fourmis granivoresgranivores ou moissonneuses, les graines constituent la partie essentielle de leur alimentation.

Une ouvrière d’une espèce d’une fourmi moissonneuse transporte une graine. © A. Wild
Beaucoup pratiquent une moisson collective en créant des pistes chimiques qui les mènent au pied des plantes arrivées à maturité. Il est très fréquent de rencontrer en région méditerranéenne ces longues files de fourmis chargées de graines. On observe facilement une relation positive entre le poids de la graine récoltée et la taille de l'ouvrière fourrageuse. Ramenées au nid, elles sont stockées dans des greniers dont l'aération en limite l'humidité. Ainsi maintenues au sec et privées par décorticage de leur enveloppe hygrophilehygrophile, les graines ne peuvent germer. Elles seront broyées par les ouvrières majors, ramollies par la salivesalive des ouvrières médias puis consommées. Il arrive que les récolteuses laissent échapper la graine pendant le transport. Ces graines germeront, favorisant la dissémination de la plante productrice.
Les fourmis moissonneuses ne sont pas les seules à cibler un seul type d'aliment.
Sucre et cochenilles au menu des fourmis
D'autres fourmis consomment exclusivement des matières sucrées. Pour ce faire, elles peuvent compter sur le hasard qui leur fait découvrir une source de matières sucrées, les exsudationsexsudations des bourgeons par exemple. Mais il est beaucoup plus sécurisant d'avoir une source sucrée permanente. Comme l'éleveur dispose de lait en permanence en soignant son troupeau de vachesvaches, les fourmis bergères d'Asie disposent d'un aliment sucré en élevant des troupeaux de cochenilles. Les cochenilles, comme les pucerons sont des homoptèreshomoptères piqueurs-suceurs qui expulsent du miellat par l'anus. Peu mobilesmobiles, elles sont inféodées à la plante qui les nourrit.

Les cochenilles fournissent une source alimentaire sucrée prisée par la fourmi d’Argentine. © A. Wild
En milieu tropical, la croissance des plantes n'est pas tributaire du rythme des saisonssaisons. On trouve côte à côte des plantes en arrêt végétatif et des plantes en pleine croissance. Seules ces dernières produisent une sève riche en acides aminésacides aminés qui nourrit les cochenilles. Ces dernières doivent donc changer régulièrement de plante-hôteplante-hôte. Dans l'île de Bornéo, ce sont les fourmis bergères Dolichoderus cuspidatus qui se chargent du transfert. Ces fourmis vivent en effet en parfaite symbiose mutualiste avec les cochenilles. Lorsqu'une plante cesse de produire la sève adéquate, les fourmis bergères construisent un nouveau réseau de pistes vers une plante fraîche. Les milliers de cochenilles qui constituent le cheptel sont transportées vers un site provisoire, une sorte de parking. Elles voyagent entre les mandibules des fourmis ou bien se font porter sur le dosdos de leurs partenaires.

Les fourmis bergères de Malaisie se nourrissent du miellat des cochenilles qu’elles élèvent. Régulièrement, elles déménagent leur cheptel pour le rapprocher de la plante nourricière. Une ouvrière de la fourmi bergère transporte ici une cochenille sur son dos. © U. Maschwitz
Quelques individus sont transportés sur une plante fraîche. Si ces individus « goûteurs » perforent les canaux conduisant la sève, le site est considéré comme favorable et l'ensemble des cochenilles sont déménagées. Si au contraire, les goûteurs refusent d'actionner leurs stylets perforants, c'est que la plante n'est pas satisfaisante. Une autre plante sera testée, toujours à l'aide des fourmis transporteuses.
Quand la bonne plante a été trouvée, les cochenilles du parking y sont acheminées. Si le nid des fourmis est trop éloigné de ce site, les ouvrières chargées de la reine et du couvaincouvain se rapprochent de leur troupeau en établissant un nouveau bivouac près de la nouvelle plante nourricière. De plus, une partie des ouvrières s'amassent autour des cochenilles, les protégeant de la pluie et de leurs prédateurs ou parasites. Bien sûr les fourmis bergères profitent pleinement du miellat produit. La symbiose mutualiste est devenue obligatoire. Les cochenilles ont absolument besoin des fourmis pour accéder à une nouvelle plante-hôte et les fourmis s'alimentent exclusivement du miellat des cochenilles. Comment ne pas faire le rapprochement avec le nomadisme, où l'homme, chargeant tentes, femmes et enfants, suit son troupeau de pâturage en pâturage ?