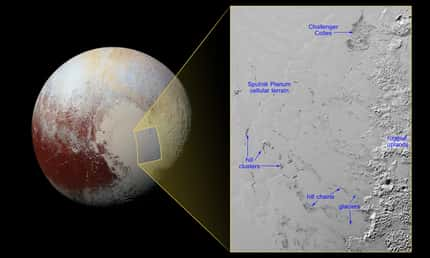au sommaire
Les îles Shetland forment un archipelarchipel entrecoupé de failles nord-est-sud-ouest et le relief en est marqué partout. On y retrouve les mêmes roches et les mêmes failles (avec des noms différents) que dans le reste de l'Écosse. Le climatclimat n'est pas si rigoureux qu'on pourrait le croire, grâce aux courants de la dérive nord-atlantique.

L'île de Noss, dans l'archipel des Shetland, en Écosse. © Vicky Brock, Wikimedia Commons, CC by-sa 2.0
Le Lewisien 2.5 Gans affleure à quelques endroits au nord de Northmavine et de West Mainland. Les Moines Rocks 1 Gans constituent l'essentiel de l'île de Yell, au nord, et affleurent à d'autres endroits de l'archipel. On en trouve à Lunna, avec des cailloux dans lesquels il y a de belles figures de microtectonique.
La formation de Dalradian 800 Mans constitue l'essentiel du Mainland : c'est le premier dépôt à contenir du calcairecalcaire formé par des bactériesbactéries combinant le CO2 de l'atmosphèreatmosphère. On trouve aussi cette formation sur l'île Unst, avec les falaises de Hermaness.
Les ophiolites des îles Unst et Fetlar
Lors de la subductionsubduction de l'océan Iapétus, un morceau de croûte océaniquecroûte océanique a été « pris » dans le soulèvement concomitantconcomitant de la chaîne : les ophiolitesophiolites de cette région sont des serpentinesserpentines, reliques d'un fond océanique disparu. Il y a des mines de talc de serpentine et de chromite sur l'île Unst. La chromite est utilisée pour la manufacture d'acier et pour faire des briques thermorésistantes. Les carrières de serpentine fournissent du ballast pour les routes, des pierres pour la construction et, dans certains cas, des pierres pour la joaillerie. Le talc est utilisé pour les céramiquescéramiques et les produits cosmétiques. D'autres petites carrières furent exploitées sur Unst au XIXe siècle : calcaire, cuivre, amianteamiante, cyanite et platine.
Les sols dérivés de la serpentine sont mieux drainés et moins acides à cause du niveau élevé en magnésium (la flore est particulière sur l'île). Bien amendés en calcaire, les sols sont assez fertiles sur l'île Fetlar.

Galets de la plage bleue, à Norwick. © Claire König, DR
Fetlar : les conglomérats
Les conglomératsconglomérats de Fetlar sont des conglomérats ordinaires, mais leur histoire ne l'est pas ! Ils ont ainsi été réchauffés et étirés par le chevauchement de la portion de croûte océanique qui leur est passée par-dessus ; le cimentciment a flué, mais l'échauffement était suffisant pour que les cailloux eux-mêmes soient déformés.

Conglomérats très écrasés sur l'île Fetlar (Funzie). © Claire König, DR
Northmavine : la faille d'Ollaberry
La Walls Boundary Fault (donc la Great Glen Fault) et la Nesting Fault, sa voisine immédiate dans le Yell Bound (qui semble postérieure), sont deux failles majeures des Shetland.
La mylonitisation semble avoir eu lieu durant le DévonienDévonien et le CarbonifèreCarbonifère. La faille était très profonde à l'origine ; l'érosion l'a ramenée relativement près de la surface. Ces failles se trouvent le long de grandes zones de cataclase (broyage d'une roche en petits éléments anguleux et déformés ; si ce phénomène est poussé à l'extrême, on obtient des mylonites) et elles ne sont pas planes.
Ces failles contiennent de l'analcime et de la laumontite, cette dernière s'est probablement formée par action mécanochimique le long de la faille. L'occurrence de ces minérauxminéraux et de veines de scapolite mylonitique semble indiquer trois phases de mouvementmouvement de ces failles entre le CrétacéCrétacé et le Dévonien à différents niveaux de profondeurs.
À Ollaberry, le schiste est très érodé, mettant en évidence le granitegranite beaucoup plus dur :
- Analcime : NaAlSi2O6.H2O tectosilicate est un minéralminéral de formation secondaire dans les cavités de roches volcaniquesroches volcaniques (basaltesbasaltes et phonolitesphonolites). On le trouve dans des syénites néphéliniquessyénites néphéliniques et roches ignéesroches ignées sodiques déficitaires en silicesilice, ainsi que dans les filonsfilons hydrothermaux.
- Laumontite : Ca(AlSi2O6)2.4H2O tectosilicate appartient au groupe des zéoliteszéolites. Elle se présente en remplissage de géodesgéodes dans les roches intrusives acides (granites et pegmatitespegmatites), dans les cavités des roches volcaniques basiques (basaltes, diabases), dans les filons de roches métamorphiquesroches métamorphiques comme produit de décomposition de l'analcime.
- Scapolite tectosilicate : groupe qui comprend la meïonite et la marialite. Ces deux espècesespèces forment entre elles une solution solidesolution solide avec pour variétés intermédiaires, le dipyre (80 à 50 % de marialite) et la mizzonite (80 à 50 % de meïonite). Ces minéraux apparaissent dans le métamorphisme régionalmétamorphisme régional facièsfaciès amphiboliteamphibolite ; ils sont également connus dans le métamorphisme de contactmétamorphisme de contact (enclaves calcaires dans les laveslaves ou dans les produits réactionnels entre roches basiquesroches basiques et magmamagma pegmatitique : pegmatitoïdespegmatitoïdes).
- Northmavine : volcanismevolcanisme. Northmavine, il y a 300-400 Mans : des désertsdéserts, des montagnes impressionnantes, de violentes éruptions volcaniqueséruptions volcaniques et coulées de lave, voire des éruptions explosiveséruptions explosives. C'est un endroit où l'on peut trouver 20 types de roches représentant 2 Gans de l'histoire turbulente de la Terre.

Dolérite et granite dans les Shetland, sur la presqu'île de Northmavine, à Mavis Grind. © Claire Konig, DR
Mavis Grind
La région de Mavis Grind, sur la presqu'île de Northmavine, dans les Shetland, était la chambre magmatiquechambre magmatique du volcanvolcan ; la doléritedolérite grise était une massemasse molle de roche il y a 370 Mans. Les passées de granite rose, molles elles aussi, ont été poussées dans la dolérite par des différences de densités dans la chambre magmatique et, finalement, les deux ont refroidi ensemble. Le volcan de type stratovolcanstratovolcan devait avoir l'allure du mont Fujimont Fuji actuel, mais il ne reste rien de l'appareil externe. Les coulées et l'appareil se sont construits sur les roches métamorphiques des montagnes précédentes, et les sandstones dévoniens.
Du point de vue géographique et historique, cet endroit est particulier : c'est le seul endroit où vous pouvez voir à la fois l'océan et la mer du Nordmer du Nord, mais le passage est étroit (de la largeur de la route) ; il était utilisé par les bateaux comme endroit de portage pour éviter de faire le tour de l'archipel jusqu'en 1950 !

Le site de Calders Geo, à Eshaness, sur l'île Shetland (Northmavine). © Claire Konig, DR
Northmavine : Eshaness
Et, pour finir, allons tout au sud, vers Catmund Carry, à la découverte de la komatiite. Kleber était le nom donné par les VikingsVikings à cette pierre. Ces derniers ne faisaient pas de poterie : trop fragile pour le transport. Ils utilisaient les matériaux disponibles : le boisbois, l'os, les peaux et la pierre. La carrière Catmund Carry a été exploitée par les Vikings du IXe au XIIIe siècle de façon « industrielle » avec un commerce à grande échelle vers les Orcades, les Féroé et l'Islande. À noter qu'en 1997 le Talc de Luzenac est venu faire des prélèvements de mineraisminerais pour analyses.

Paysage côté pays de Northmavine (Eshaness). © Claire Konig, DR
La stéatite (pierre ollaire-schiste talco-magnésique) est claire et coupée par des bandes épaisses de serpentine verte, altération de l'olivineolivine initiale des laves ultrabasiquesultrabasiques de cet endroit. L'altération est due à de très chauds courants hydrothermaux qui ont produit la serpentine et, dans le cas d'une altération maximum, le talc. L'analyse détaillée des roches permet d'affirmer qu'à l'origine ces laves étaient des komatiites.
Les études d'anomaliesanomalies magnétiques et de gravitégravité montrent que ces roches s'étendent sur plus de 120 km vers le nord, et ont donc des implications importantes avec le complexe ophiolitique de Unst.
La komatiite
La komatiite est une roche rare mais on en trouve en Afrique du Sud. Elle est constituée de cristaux d'olivine en aiguilles qui lui donnent sa structure caractéristique ; ceux-ci s'altèrent en serpentine, puis en talc...
Les laves komatiitiques sortent à très hautes températures, aux alentours de 1.600 °C ; elles représentent donc des laves très profondes et très chaudes du manteaumanteau. Depuis que la Terre s'est formée, le manteau s'est refroidi, donc les komatiites viennent des grandes profondeurs et sont de plus en plus rares avec le temps... surtout dans des roches aussi jeunes (OrdovicienOrdovicien). La plupart existent en effet dans des roches archéennes.
La présence de komatiite de grande profondeur ici est sans doute due à la profonde fracture de la croûte terrestrecroûte terrestre dans un bassin intracontinental qui donnera naissance à l'océan Iapétus : elle marque l'endroit où les continents se sont séparés à l'ouverture de cet océan il y a 600 Mans.