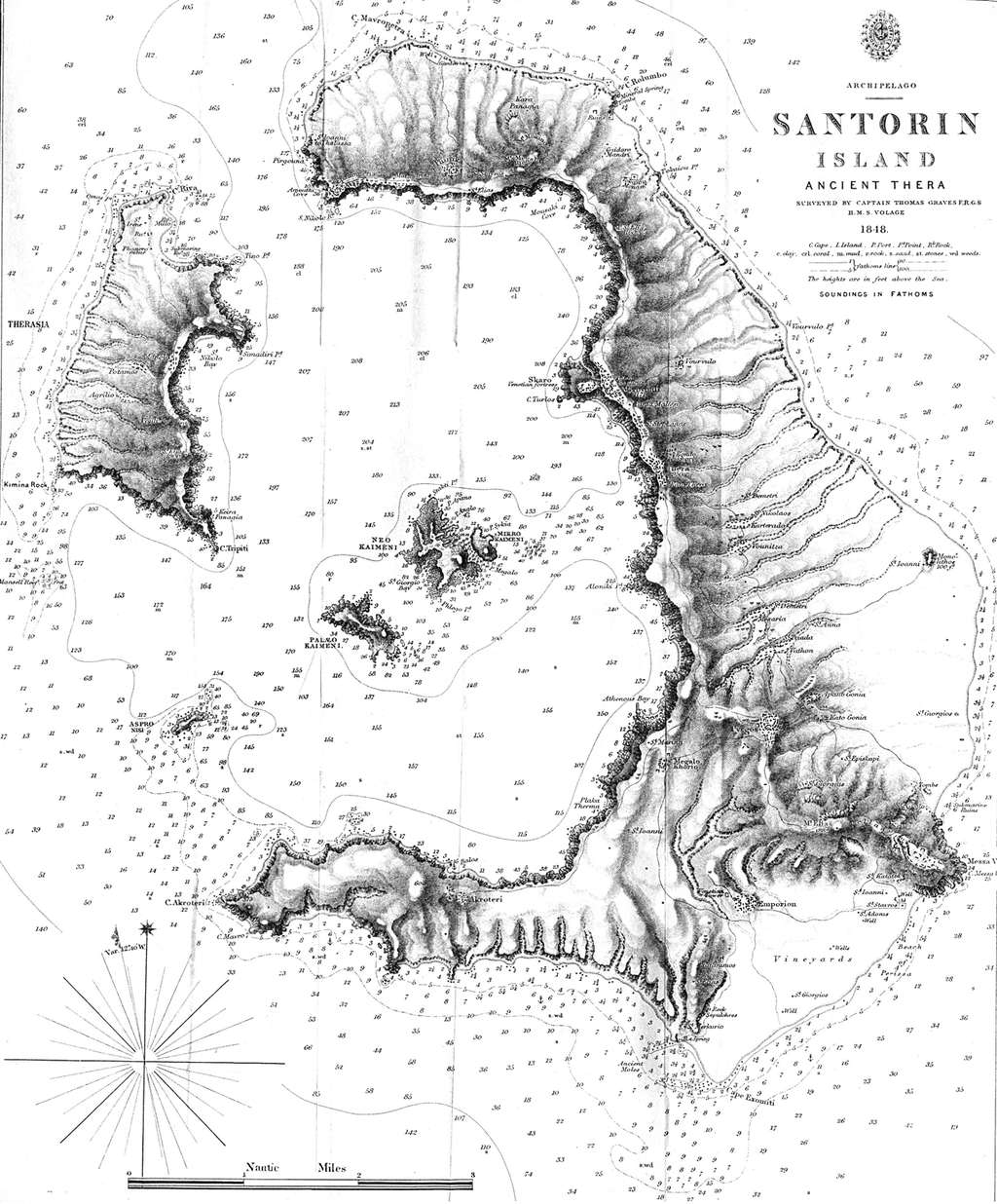Objet d'un intense commerce dans les Cyclades et au-delà, l'obsidienne de Milos a permis d'éclairer bien des points de la circulation méditerranéenne de l'âge du bronze ancien.
Escale à Milos

Des syrmatas, anciens abris pour pêcheurs et barques, dont la plupart sont aujourd’hui loués aux touristes, à Milos. © Oliwan, cc by 3.0
Du point de vue tectonique, Milos appartient à l'arc volcaniquearc volcanique sud de l'Égée. Elle se trouve sur la plaque eurasiatique, à 220 km de la faille due au glissement de la plaque africaine sous la plaque eurasiatique. Cette dernière glisse de 2,5 cm par an. Il y a un enfoncement sensible dans la partie sud, ce qui signifie que l'île se trouve en submersionsubmersion, en raison sans doute du frottement des deux plaques. Outre les roches volcaniquesroches volcaniques, on trouve quelques roches sédimentairesroches sédimentaires vers Provatas et quelques roches métaphoriques.

Les plages de Milos. © Agisfere, cc by 3.0
On trouve deux volcansvolcans sur cette île : le volcan de Fyriplaka, au milieu de la côte sud, et le volcan de Trachila, à la pointe nord-nord-ouest. Les dômes sont constitués d'andésiteandésite qui peut avoir la forme de colonnes polygonales de 20 à 30 cm de diamètre.
On remarque l'odeur et la couleur jaune caractéristiques du soufre, ainsi qu'une température très élevée du sol. On peut voir des émanations sous-marines de gaz à Aghia Kyriaki, Paléohori ou Kanava. Outre les fumerollesfumerolles, on trouve aussi des sources thermalessources thermales, comme à Adamas, avec essentiellement du chlorure de sodium, mais aussi des sels sulfuriques, des carbonates et des silicatessilicates de calcium, de magnésiummagnésium, de potassiumpotassium et d'ammonium.

La mine de soufre de Milos. © Zartosht, GNU 1.2
Une roche vitreuse et riche en silice
Outre Lipari et la Sardaigne et le Caucase, Milos fut un grand fournisseur d'obsidienne de la Méditerranée depuis des époques reculées. Les carrières de Dhemenegaki et de Sta Nychia (Adamas) sont les plus importantes d'un point de vue archéologique, en termes de duréedurée et d'extension de la diffusiondiffusion de l'obsidienne. Dhemenegaki est plus difficile d'accès, ses veines étant situées en sommet de falaise.

Miroirs en obsidienne datant du Néolithique, trouvés à Çatal Höyük, en Turquie. © Omar Hoftun, cc by 3.0
Les sources d'obsidienne sont situées sur l'arc volcanique, à Antiparos, en position interne, ou à Milos dans la partie méridionale, plus récente et source principale de l'obsidienne égéenne. Ces gisementsgisements ont été exploités depuis XIe millénaire avant J.-C.

Pointes de flèche du Néolithique : on trouve les mêmes en obsidienne. © Descouens, cc by nc 3.0
C'est au VIIe millénaire avant J.-C. que l'obsidienne de Milos, attestée au Néolithique ancien, connaît son expansion majeure, jusqu'en Thessalie et Macédoine. On la trouve aussi en Crète, dès 7000 avant J.-C.
L'obsidienne de Milos a été utilisée pour fabriquer des burins, racloirs, perçoirs, rasoirs, etc. En gros, tout ce qui doit être pointu ou tranchant. Même l'apparition des outils en métalmétal n'a pas détrôné l'obsidienne. Il faut dire qu'un éclat d'obsidienne est très tranchant et tient bien la coupe, ce qui n'était pas le cas des premiers outils en métal, trop mous pour être très résistants, même si leur longévité était plus grande. Certaines de ces lames peuvent atteindre 23 cm de long : de véritables chefs-d'œuvre de débitage par percussion.
Au Bronze moyen, on l'utilise encore pour des pointes de flèche chez les guerriers et chasseurs mycéniens. À l'apparition du ferfer, son utilisation cesse progressivement.
HérodoteHérodote, Pline et Théophraste mentionnent l'utilisation en Grèce de l'obsidienne pour des miroirsmiroirs, des sceaux, les yeuxyeux de statues et certaines mosaïques.