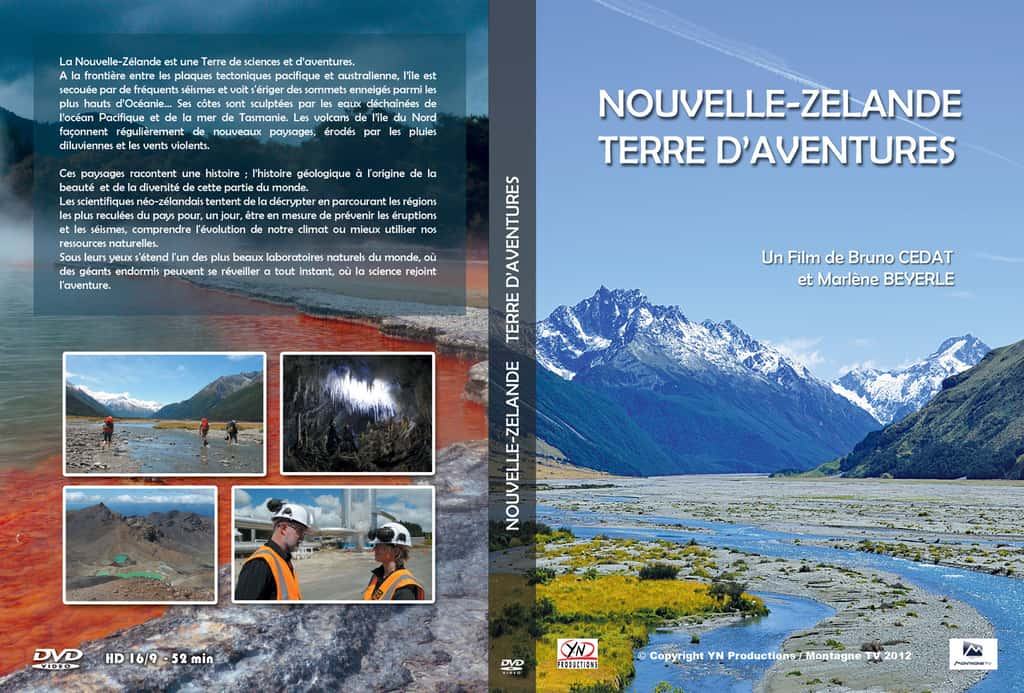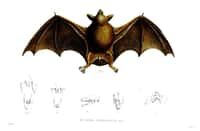au sommaire
La chaleur résiduelle des volcansvolcans crée une forte activité géothermique dans la région : l'eau qui s'infiltre dans le sol est chauffée au contact des roches brûlantes et remonte à la surface, créant des sources chaudessources chaudes, des geysersgeysers, des mares de boue et des fumerollesfumerolles.

L'étude des organismes extrêmophiles
Dans la région de Rotorua, la nature offre un spectacle extraordinaire fait de remous, de fumée et de couleurs. Des palettes de teintes vives s'étendent devant les yeuxyeux des visiteurs. Les couleurs sont dues principalement à la présence de bactériesbactéries et de microalgues extrêmophilesextrêmophiles, qui se développent dans des conditions extrêmes de température et d'acidité ou en présence de métauxmétaux lourds. La composition chimique, le pH, la température et la concentration en oxygène sont des facteurs qui sélectionnent les micro-organismesmicro-organismes.

Un changement de couleur reflète donc un changement dans l'environnement. Il est par exemple possible de deviner la température rien qu'en observant les couleurs !

De nombreuses espècesespèces extrêmophiles restent à identifier. Elles font l'objet de nombreuses études, avec en filigrane leur possible utilisation industrielle, notamment dans la dépollutiondépollution (dégradation d'hydrocarbures, traitement des métaux lourds, etc.).
L'utilisation de la géothermie en Nouvelle-Zélande
Dans certaines zones, la vapeur qui remonte à la surface est chargée de gaz tels que le sulfure d'hydrogènesulfure d'hydrogène (H2S) ou le dioxyde de carbonedioxyde de carbone (CO2). Ils acidifient les eaux de surface qui attaquent les roches volcaniques et forment d'étranges marmites de boue. Leur bouillonnement est en grande partie dû à la remontée de bulles de gaz. Cette chaleur peut être récupérée afin de produire de l'électricité. La géothermie représente une ressource énergétique énorme, que les Néo-Zélandais ont appris à maîtriser.

Dans la région de Taupo, une gigantesque centrale géothermiquecentrale géothermique a été construite. Des kilomètres de tuyaux parcourent le champ géothermique de Wairakei. La technologie développée est relativement simple : un forage dans le sous-sol permet de récupérer un mélange d'eau et de vapeur à haute température. Ce mélange passe dans un séparateur. La vapeur sèche est conduite jusqu'à la centrale géothermique, où elle fait tourner une turbine pour générer de l'électricité. L'eau encore tiède peut être utilisée dans une centrale binairebinaire qui fonctionne comme un gigantesque échangeur thermique : elle vaporise un liquideliquide très volatil, comme l'isopentane, qui fait tourner une autre turbine. L'eau est ensuite réinjectée dans le sol ou mélangée à de l'eau de rivière.

Actuellement, 13 % de l'électricité de la Nouvelle-Zélande provient de ressources géothermiques. Le défi des scientifiques est désormais d'exploiter les ressources profondes. Généralement, les forages ne dépassent pas 3,5 kilomètres de profondeur. Or, les ressources énergétiques plus profondes sont énormes. Si le développement de nouvelles techniques pouvait permettre de récupérer ne serait-ce qu'un petit pourcentage de cette énergieénergie, cela couvrirait la demande énergétique croissante de la Nouvelle-Zélande. C'est l'objectif les 15 à 20 prochaines années.