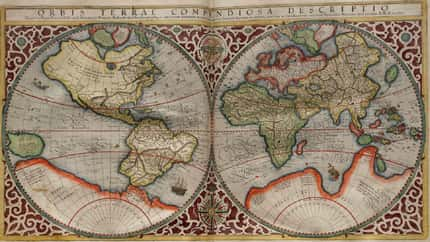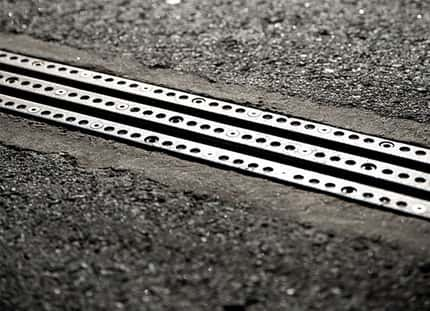au sommaire
En forme de pains de sucresucre, ils semblent jaillir de terre aux milieux des grands espaces. Le mont Mézenc et le célèbre mont Gerbier de Jonc sont les deux sucs les plus connus. Ici, les fermes massives et basses avec les toitstoits de lauze témoignent d'hivershivers rudes. On peut malgré tout découvrir des tulipes sauvages et le lys martagon qu'un œilœil averti saura reconnaître sous le regard aigu de l'aigle royal.

Sur les terres volcaniques ardéchoises, partons à la découverte de cinq étapes jalonnées de paysages grandioses.
Première étape : Sainte-Eulalie
C'est une petite ville qui porteporte, comme nous l'avons vu au chapitre précédent, un nom assez fréquent, mais où on peut se promener dans un bâti traditionnel typique de la montagne ardéchoise. Un patrimoine architectural bien mis en valeur, entre autres, sur la place du village.

Deuxième étape : sur la route des sucs, Sagnes-et-Goudoulet
Les communes françaises doivent tenir le record européen de la « petite commune » et pourtant avec 116 habitants, Sagnes-et-Goudoulet (altitude : 1.230 mètres) résulte de la fusion en 1790 de deux communautés : Les Saignes et Goudoulet.
Les constructionsconstructions sont couvertes de lauze et il existe cinq fermes au toit de genêts, c'est quelque chose de vraiment rare de nos jours même si dans bien des régions on trouve encore du jonc ou du chaumechaume !
- La Ferme des grands Sagnes est un ancien prieuré de l'abbaye de la Chaise Dieu, du XIIIe siècle, elle existait alors sous le nom de Saint-Robert. De ce fait, la commune appartient au réseau européen Casadéi, des sites casadéens. À proximité, une voie entièrement pavée a été conservée et encore une fois, une petite promenade s'impose. Visites guidées du village sur réservation auprès de l'Office de tourisme intercommunal du pays des sources de la Loire (04 75 38 89 78).
- La montagne « Les Coux » est un ancien site d'occupation gauloise (probablement un temple). Au sommet, un plateau de steppesteppe froide, un milieu qui devient rare aussi avec : bruyères, myrtilles mais aussi l'herminehermine, la belettebelette et la marmotte.

- La tourbièretourbière de la Padelle : accessible du village est riche par sa flore.
- La forêt du Goudoulet : elle appartenait à l'abbaye d'Aiguebelle.
- Lachamp du Mezy vous permet d'admirer un des plus beaux panoramas de sucs.
- La grange de Dizonenche appartenait aux Chartreux de Bonnefoy et était une herboristerie.
- La ferme Bourlatier date du XVIIe siècle, est devenue « ferme Mémoire » de la montagne ardéchoise.

Troisième étape : la cascade du Ray-Pic
La cascade du Ray Pic est située sur la D 215 entre Burzet et Lachamp Raphaël. Il y a quelques milliers d'années, le volcan du Ray-Pic était actif. Il est à l'origine d'une des plus longues coulées de lave de France, soit 20 kilomètres. La rivière Bourges franchit cette coulée par un petit canyon se terminant par une chute de 35 mètres. Le charmecharme tient dans les couleurs : noir de la pierre, blanc de l'écumeécume... et les texturestextures, figée de la coulée, mouvante de la cascade. En raison de son intérêt paysager, la cascade de Ray-Pic est protégée depuis 1931. Le basaltebasalte est, ici, partout présent, l'Ardèche est volcanique dans la région !
Quatrième étape : le col du Pranlet
Le col du Pranlet est un lieu de passage lors des migrations d'oiseaux et aussi un endroit remarquable au niveau botaniquebotanique.
Dernière étape : Borée
Borée, commune de 146 habitants (encore une commune minuscule !), se trouve sur la route D 533.

Borée est le dieu des VentsVents du Nord, fils de l'Aurore et d'un TitanTitan. Cette fable a été inspirée à Jean de La Fontaine (livre VI, fable 3) par Esope qui a beaucoup inspiré le poète français. C'est une des meilleures fables, parfaitement construite : on y voit le fabuliste animer les dieux, leur prêter sentiments et caprices humains.
Borée et le soleil virent un voyageur
Qui s'était muni par bonheur
Contre le mauvais temps. On entrait dans l'automneautomne,
Quand la précaution aux voyageurs est bonne :
Il pleut, le soleil luit, et l'écharpe d'IrisIris
Rend ceux qui sortent avertis
Qu'en ces mois le manteaumanteau leur est fort nécessaire;
Les Latins les nommaient douteux, pour cette affaire.
Notre homme s'était donc à la pluie attendu :
Bon manteau bien doublé, bonne étoffe bien forte.
«Celui-ci, dit le vent, prétend avoir pourvu
A tous les accidentsaccidents; mais il n'a pas prévu
Que je saurai souffler de sorte
Qu'il n'est bouton qui tienne; il faudra, si je veux,
Que le manteau s'en aille au diable.
L'ébattement pourrait nous en être agréable :
Vous plaît-il de l'avoir ? - Eh bien, gageons nous deux,
Dit Phébus, sans tant de paroles,
A qui plus tôt aura dégarni les épaules
Du cavalier que nous voyons.
Commencez : je vous laisse obscurcir mes rayons.»
Il n'en fallut pas plus. Notre souffleur à gage
Se gorge de vapeurs, s'enfle comme un ballon,
Fait un vacarme de démondémon,
Siffle, souffle, tempêtetempête, et brise en son passage
Maint toit qui n'en peut mais, fait périr maint bateau,
Le tout au sujet d'un manteau.
Le cavalier eut soin d'empêcher que l'orageorage
Ne se pût engouffrer dedans;
Cela le préserva. Le vent perdit son temps;
Plus il se tourmentait, plus l'autre tenait ferme;
Il eut beau faire agir le colletcollet et les plis.
Sitôt qu'il fut au bout du terme
Qu'à la gageure on avait mis,
Le soleil dissipe la nue,
Récrée et puis pénètre enfin le cavalier,
Sous son balandras fait qu'il sue,
Le contraint de s'en dépouiller :
Encor n'usa-t-il pas de toute sa puissance.
Plus fait douceur que violence.