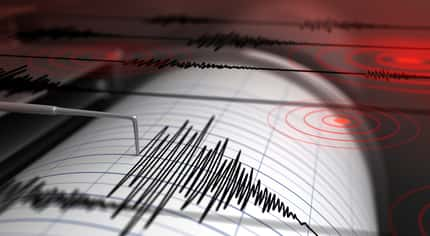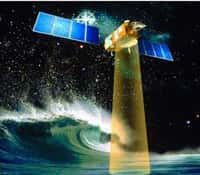au sommaire
- À lire aussi
D'autres exemples sont encore présentés sur le site : Opération GlaciersGlaciers. Tous n'illustrent toutefois qu'une infime partie des changements intervenant jour après jour, année après année dans l'environnement de haute montagne. Changement climatiqueChangement climatique ou pas.

Comme indiqué en introduction, tout un chacun peut expérimenter de facto ces modifications, que ce soit le front d'un glacier qui se retire, la végétation qui colonise l'espace libéré, un lac qui se forme ou qui disparaît, ou beaucoup d'autres choses encore. Le paysage alpin change, évolue. La comparaison de photographiesphotographies anciennes (quelques années peuvent suffire) avec le paysage actuel est un outil à la fois pratique et à la portée de tous.
L'Opération Glaciers s'est déroulée en 2002 et le texte sur lequel se base ce dossier date de la même époque. Après l'été caniculaire de 2003, on peut dès lors se demander quelles en ont été les conséquences sur l'état des glaciers et parois glaciaires des Alpes ?
Concernant les glaciers, l'accumulation de neige durant l'hiverhiver 2002/2003 a été proche des valeurs moyennes. L'été 2003, par contre, a connu en montagne des températures de l'ordre de 4°C supérieures à la norme durant les quatre mois de juin à septembre, avec des dépassements exceptionnels en juin et août. Les premières estimations (Prof. W. Haeberli, Zurich) indiqueraient une diminution d'épaisseur globale des glaciers des Alpes Suisses atteignant 3 m durant cette année, une valeur 6 fois supérieure aux pertes déjà importantes subies annuellement depuis 1980-1985 environ. Ceci pourrait se traduire, prochainement, par le retrait accéléré de nombreux glaciers. Tout dépendra toutefois des conditions climatiques qui régneront ces prochaines années.
En ce qui concerne les parois glaciaires, l'enneigement de l'hiver leur a été défavorable. Il s'est en effet concentré sur les mois de janvier et février, période durant laquelle les températures sont beaucoup trop froides pour permettre à la neige d'adhérer convenablement aux pentes extrêmement raides. Les chutes de neige printanières ou même estivales, qui se produisent par des températures bien plus élevées et qui, plus humides, ont la faculté d'adhérer beaucoup plus facilement, ont été pour ainsi dire inexistantes en 2003. Ainsi, à la fin du mois de juin, l'état d'enneigement des grandes faces était déjà proche de celui connu habituellement en fin d'été. Les grandes chaleurs et l'ensoleillement exceptionnel qui se sont prolongés durant l'intégralité de la saisonsaison estivale ont par la suite provoqué un retrait considérable de la couverture de glace (où elle existe encore), ainsi qu'un dégel prononcé du substratsubstrat rocheux désormais exposé. S'en sont suivies durant tout l'été, de très fréquentes et importantes chutes de pierres, atteignant parfois des ampleurs inhabituelles.

Qu'en sera-t-il en 2004 et dans les années qui suivent ? Dénichez d'anciennes photos et allez observer de vos propres yeuxyeux !