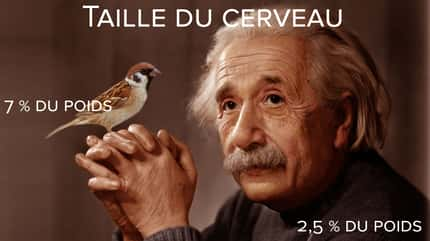au sommaire
Ragondin (Molina 1792) - Myocastor coypus
- Ordre : Rodentia (Rodentiens = anciennement Rongeurs)
- Sous-ordre : Hystricognatha
- Infra-ordre : Hystricognathi
- Famille : Myocastoridae
- Sous-famille : Myocastorinae
- Genre : Myocastor
- Taille : 40 à 60 cm (longueur de la queue 25 à 40 cm)
- Poids : 5 à 9 kgkg (la moyenne est de 6 kg)
- Longévité : 4 ans en moyenne
Statut de conservation UICNUICN : LC Préoccupation mineure
Description du ragondin
Le ragondin est un mammifère trapu d'assez grande taille, dont le corps recouvert d'une épaisse fourrure imperméable, est terminé par une queue cylindrique qui s'effile à son extrémité. La couleurcouleur du pelage varie du gris clair au marron avec des nuances brunes sous les oreilles, les joues et sur la poitrine. La toison est constituée de deux couches distinctes de poils : la sous-couche très dense et courte assurant l'imperméabilité, et les jarres plus longues formant la couche supérieure qui isole du froid. L'animal possède deux petits yeuxyeux et des narinesnarines placés très haut sur la tête qui lui permettent de voir et de respirer dans l'eau. Les narines possèdent la faculté de s'obturer lorsque l'animal plonge sous l'eau. Les oreilles sont rondes et petites. Le museau est équipé de longues vibrisses grises et ses mâchoires de quatre longues incisives de teinte orangée. Les poils du museau sont grisonnants également. Les pattes antérieures sont munies de longues griffes servant à creuser et à tenir les aliments, tandis que les pattes postérieures palmées sont destinées à la propulsion dans l'eau.

Habitat du ragondin
Originaire d'Amérique du Sud, le ragondin a été importé au XIXe siècle pour la pelleterie. Les populations actuelles sont issues d'échappés d'élevage ou de lâchers volontaires. Le rongeur s'est installé durablement dans 70 départements français et commence à coloniser d'autres pays européens, le Proche-Orient et les états sudistes d'Amérique du Nord. Il fréquente presque tous les plans d'eau douce calme tels que les marais, les étangs, les canaux bordés de végétation et toutes les zones humideszones humides en général. Il craint les hivershivers froids car sa queue, très sensible, peut geler et entraîner la gangrènegangrène, puis la mort.

Comportement du ragondin
Le ragondin est un animal parfaitement adapté à la vie aquatique. Il creuse des terriers de plusieurs mètres de long dans les berges. Ceux-ci possèdent plusieurs entrées dont une est immergée. Un nid d'herbes est aménagé dans l'élargissement d'un des tunnels, dans lesquels la femelle mettra ses petits au monde et les allaitera les premiers jours. Ses mœurs sont essentiellement nocturnesnocturnes mais il possède une activité diurnediurne non négligeable. Dans la journée, ils se tiennent souvent sur des radeaux de plantes aquatiques ou sur des troncs affleurant la surface de l'eau. Le ragondin utilise toujours les mêmes accès pour sortir de l'eau et aller sur nourrir sur terreterre. Ces passages sont appelés coulées. C'est un animal sédentaire dont le territoire se limite à quelques centaines de mètres carrés. Son odoratodorat et son ouïe sont particulièrement développés, mais sa vision est très faible. Il est quasiment myope et se laisse facilement approcher. Alors que dans son pays d'origine, les populations sont régulées par les caïmanscaïmans, les jaguarsjaguars et autres félidésfélidés, il n'a pas de prédateurs sous nos latitudeslatitudes, à l'exception des jeunes qui peuvent être la proie de rapacesrapaces ou de renards.

Reproduction du ragondin
Après une gestationgestation d'un peu plus de quatre mois, la femelle peut avoir deux ou trois portées de cinq à sept petits par an (selon les disponibilités en ressources alimentaires), qu'elle allaite pendant environ huit semaines avant qu'ils ne deviennent indépendants. Les mamelles de la mère sont situées sur les flancs et non sur le ventre comme les autres mammifères, ce qui lui permet de nager alors que les jeunes sont accrochés aux tétines. Les ragondins atteignent leur maturité sexuelle au bout de six mois et vivent en couple, parfois en colonies importantes.

Régime alimentaire du ragondin
Le ragondin a un régime essentiellement végétarienvégétarien. Il se nourrit de feuilles et de tiges de végétaux aquatiques, de racines et de tuberculestubercules, parfois d'écorces de jeunes arbresarbres, mais ne dédaigne pas les fruits et les légumes lorsqu'il en trouve. Compte tenu de la faible teneur en nutrimentsnutriments des végétaux qu'il absorbe, le ragondin qui pratique la double digestiondigestion est obligé, pour éviter les carencescarences, de consommer les caecotrophes (sortes de crottes humides et luisantes se présentant en grappes) issues de la première phase de digestion.

Menaces sur le ragondin
Compte tenu de ses capacités d'adaptation et de sa forte natalité, le ragondin n'est absolument pas menacé même s'il est traqué et piégé à cause des dégâts qu'il peut provoquer aux berges et dans les cultures.

Le saviez-vous ?
Le ragondin est vecteur d'une zoonosezoonose : la leptospiroseleptospirose parfois appelée maladie du rat. Il est fortement déconseillé de tremper ses mains dans l'eau ou de se baigner dans les eaux stagnantes, et de ne pratiquer ce dernier exercice que dans les plans d'eau aménagés à cet effet, dans lesquels l'eau est régulièrement analysée. En effet, la leptospirose est une maladie bactérienne sévère qui, si elle n'est pas diagnostiquée à temps, peut entraîner des troubles graves aux reinsreins et au foiefoie. Cette affection atteint principalement les professionnels (éleveurs, égoutiers, pisciculteurs...) mais peut toucher également les adeptes des loisirs aquatiques (pêchepêche, canyoning, rafting...) par contact avec les eaux douces souillées par des animaux atteints de la maladie.