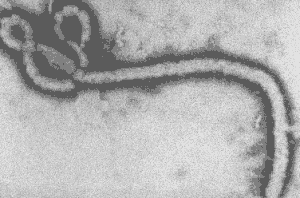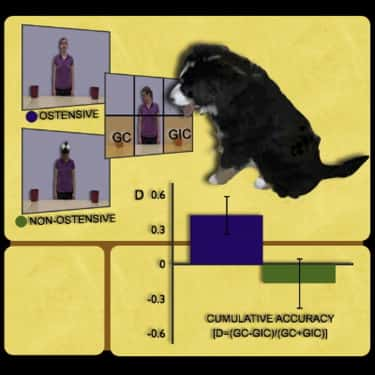au sommaire
- À lire aussi

Chien infecté par la leishmaniose viscérale. Il est réservoir domestique de la maladie. © IRD/Fournet, Alain
Cette maladie, pour laquelle il n'existe aucun vaccinvaccin, s'avère rapidement mortelle en absence de traitement. Dans les zones touchées, la population canine, massivement affectée, constitue un "réservoir" de parasites pour l'homme.
Ce protozoaireprotozoaire flagellé utilise comme vecteur un insecte qui ressemble à un petit moucheron, le phlébotome, dont il colonise l'intestin puis les glandes salivairesglandes salivaires. L'insecte
femelle, qui se nourrit de sang de mammifère, peut ainsi transmettre le parasite à l'homme par simple piqûre. Une fois introduit dans la circulation sanguine, L. infantum se réfugie dans des cellules particulières du système immunitairesystème immunitaire, les macrophagesmacrophages. Ceux-ci finissent par éclater, libérant les parasites qui vont pénétrer dans de nouvelles cellules. La maladie se traduit chez la personne infectée par des poussées de fièvrefièvre, une anémieanémie et un amaigrissement.
Le phlébotome se nourrit également du sang d'autres mammifères que l'homme. C'est ainsi que sur le pourtour méditerranéen, 5 millions de chiens, soit 1 à 42 % selon la zone, sont atteints de leishmaniose viscéraleleishmaniose viscérale. Ces animaux constituent un véritable réservoir de parasites, qui approvisionne de manière continue le cycle mammifères-phlébotome-homme.
Les chercheurs se sont également penchés sur les changements immunitaires induits par la vaccinationvaccination chez les animaux. Des expériences réalisées au laboratoire montrent que l'efficacité du vaccin se traduit par une activation de certaines cellules du système immunitaire, les lymphocyteslymphocytes TT de type Th1. Ceux-ci induisent la production, par les macrophages infectés, d'un véritable poison cellulaire, l'oxyde nitriqueoxyde nitrique. Ce processus, absent chez le chien non traité, permet ainsi aux macrophages de se débarrasser des parasites qui les infectent. L'animal est ainsi protégé à long terme contre la leishmaniose viscérale.
La mise au point d'un vaccin canin pourrait, en réduisant ce réservoir, limiter la transmission de la maladie à l'homme. Un tel traitement de prévention vient d'être testé avec succès sur des chiens par une équipe de l'IRDIRD de Montpellier, en collaboration avec la clinique vétérinairevétérinaire du Rocher (La Garde, Var) et l'entreprise biopharmaceutique Bio Véto Test (La Seyne-Sur-Mer, Var).
Les premiers résultats, qui révèlent en effet une protection totale et durable de ces animaux contre la maladie, pourraient ouvrir la voie à l'élaboration d'un éventuel vaccin humain.