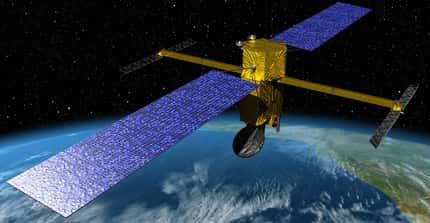au sommaire
- À lire aussi

(crédit : www.cirs.net)
Dans les Andes tropicales, le recul des glaciers s'est considérablement accéléré depuis une trentaine d'années. Cette évolution est d'autant plus inquiétante que l'approvisionnement en eau de nombreuses régions andines dépend des glaciers de la Cordillère.
Afin de mieux comprendre les mécanismes qui lient cette fontefonte au climat, les chercheurs de l'unité Great Ice (UR032) de l'IRD ont mis en place depuis 1991, en collaboration avec leurs partenaires boliviens, équatoriens et péruviens, un réseau d'observation comprenant une dizaine de glaciers le long des Andes entre l'équateur et le 16°sud (Bolivie). Contrairement aux glaciers alpins qui connaissent une longue période d'accumulation en hiver et une courte saisonsaison d'ablationablation en été, les glaciers des Andes tropicales sont soumis toute l'année à un régime d'ablation dans leur partie inférieure, avec un maximum durant l'été austral (octobre-avril) en Bolivie et au Pérou. C'est à cette saison en effet, que coïncident la plus forte insolationinsolation et le maximum de précipitationsprécipitations. Les glaciers, qui réagissent fortement aux variations de ces deux paramètres, constituent des indicateurs très sensibles des modifications du climat. Les chercheurs se sont intéressés à deux glaciers représentatifs de ceux qui parsèment la Cordillère, l'Antizana (5760m-4800m) en Equateur et à Chacaltaya (5375m-5125m) au nord de la Bolivie.
Le bilan de massebilan de masse des glaciers, qui évalue la différence entre l'accumulation de neige et de glace et leur ablation par fusionfusion et sublimationsublimation, apparaît étroitement contrôlé par l'ENSO (El NiñoEl Niño-SouthernSouthern Oscillation). Durant les phases chaudes (El Niño), les bilans sont en effet toujours négatifs, les glaciers perdant dans l'année une lame d'eau de 600 mm à 1200 mm. En revanche, en régime La NiñaLa Niña, plus froid et plus humide, les glaciers s'équilibrent et parviennent parfois à dégager un excédent qui enraye temporairement leur déclin.
Afin d'identifier les processus physiquesphysiques responsables de la fonte et de la sublimation à la surface des glaciers, les chercheurs ont effectué des bilans d'énergieénergie sur le Zongo (16°S) en Bolivie, un glacier proche de celui de Chacaltaya, et sur l'Antizana (0°28S) en Equateur. Ces bilans permettent de connaître la quantité d'énergie, issue de la radiation solaire et des flux turbulents, reçue et absorbée par le glacier. Ces quantités sont calculées à partir de mesures météorologiques (taux d'humidité, températures, vitessevitesse et direction du ventvent, etc.) effectuées à la surface du glacier au cours d'années entières. L'étude des bilans d'énergie montre que la fonte des glaciers est contrôlée principalement par le rayonnement net, qui représente la part de l'énergie radiative absorbée par le glacier. Ceci souligne le rôle déterminant du pouvoir réfléchissant de la surface du glacier, l'albedo. La fonte est maximale pendant l'été austral (octobre-avril) en Bolivie et les mois proches des équinoxeséquinoxes en Equateur (avril-mai et septembre), dès lors que l'apport énergétique et l'humidité atmosphérique sont à leur maximum.
Pendant les périodes El Niño, les précipitations baissent de 10 % à 30 % et la limite pluie-neige sur les glaciers s'élève de 200 m à 300 m par suite de l'échauffement de l'atmosphèreatmosphère de 1°C à 3°C. L'albedo est ainsi maintenu à des valeurs basses et la fonte s'accélère. Cependant, alors qu'en Bolivie les processus d'accélération de la fonte résulte de la baisse des précipitations, essentiellement sous forme de chutes de neige (donc à albedo élevé), en Equateur ils sont davantage liés à l'augmentation de la température atmosphérique qui change les précipitations nivales en pluie sur la moitié inférieure du glacier. En revanche, durant les périodes La Niña où l'atmosphère est plus froide et les précipitations fréquentes et abondantes, la surface du glacier reste couverte d'un manteaumanteau neigeux protecteur à fort albedo.
L'analyse des bilans de masse effectués sur plusieurs décennies à l'échelle des Andes centrales montre que les glaciers offrent une réponse cohérente au même signal climatique, les périodes de fonte intense coïncidant, avec un décalage de 2 à 3 mois, avec les épisodes El Niño dans le Pacifique. Aussi l'augmentation de la vitesse du recul des glaciers depuis la fin des années 1970 apparaît-elle synchronesynchrone avec le changement de phase du Pacifique ("Pacific shift") de 1976, date à partir de laquelle les phénomènes El Niño sont devenus plus fréquents et plus intenses. Le déficit annuel moyen du glacier de Chacaltaya en Bolivie est ainsi passé de 0,6 m d'eau entre 1963 et 1983 à plus de 1,2 m entre 1983 et 2003. À ce taux, il devrait disparaître avant 2015.
À l'échelle séculaire, le mode oscillatoire de l'ENSO se superpose à la tendance au recul qui touche les glaciers des Andes centrales depuis au moins 1880 (fin du Petit Age Glaciaire). Les phases chaudes accélèreraient donc la déglaciation en renforçant cette tendance attribuée au réchauffement globalréchauffement global qui, depuis 25 à 30 ans, s'effectue dans la cordillère au rythme accéléré de 0,3°C par décennie.
Les chercheurs de Great Ice travaillent actuellement à modéliser la réponse des glaciers aux scénarios climatiques prévus au XXIe siècle par les modèles de circulation générale pour les Andes tropicales. Ils devraient ainsi offrir aux populations qui vivent de la ressource en eau des glaciers un moyen de prévision efficace de la quantité d'eau disponible à l'avenir.