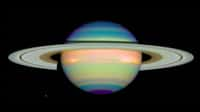Il y a 183 millions d’années, une sévère crise biologique entraînait la disparition de nombreuses espèces marines. En cause : la hausse dramatique des taux de CO2 dans l’atmosphère ayant entraîné une chute de l’oxygénation des océans. Une nouvelle étude révèle que nous filons tout droit vers ce type de catastrophe. À la différence près qu’il ne nous faudra pas 300 000 ans pour l’atteindre.
au sommaire
Le Jurassique est souvent considéré comme « la » période géologique qui a vu le règne des dinosaures s’établir de façon claire. Le début de cette période est en effet marqué par la résiliencerésilience des écosystèmes suite à la sévère extinction de masse qui a signé la fin du Trias, il y a environ 200 millions d'années. Le climat, tempéré et humide, voire chaud (5 à 10 °C de plus qu'actuellement), est alors propice à la radiation évolutiveradiation évolutive de nouvelles espèces, notamment chez les dinosaures et les mammifèresmammifères, qui vont prendre place dans les niches écologiques laissées vacantes par cette récente crise biologique. Les terresterres du supercontinentsupercontinent PangéePangée, qui commence à se disloquer, sont alors couvertes de jungles luxuriantes. On pourrait considérer qu'il s'agit du début d'un âge d'or pour les espèces qui se développent rapidement. Pourtant, la situation n'a pas été si idyllique que ça.
300 000 ans d’intense activité volcanique vont modifier le climat
Comme toujours, le climat a joué les fauteurs de troubles. Le début du Jurassique, et plus particulièrement la transition entre le Pliensbachien et le Toarcien il y a 183 millions d'années, est marqué par un épisode climatique extrême. Les taux de CO2 dans l'atmosphèreatmosphère, déjà élevés à cette période, vont en effet bondir sous l'effet du dégazagedégazage des énormes quantités de lavelave (plus de 2,5 millions de kilomètres cubes) émises par l'éruption des grandes provinces ignées du Karoo-Ferrar. La formation de cet immense plateau magmatique qui se situe aujourd'hui en Afrique du Sud et en AntarctiqueAntarctique va en effet libérer 20 500 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère sur une période de 300 000 à 500 000 ans. Cette évolution de la composition atmosphérique va entraîner un « super-effet de serreeffet de serre » qui va se traduire par un réchauffement climatiqueréchauffement climatique global. Si le milieu terrestre est impacté (on note la disparition de plusieurs cladesclades de dinosaures à ce moment-là), le milieu marin n'est pas non plus épargné et va subir de plein fouet cette évolution des conditions environnementales.

Paysage du Drakensberg (Afrique du Sud) où se sont superposées de nombreuses coulées de basaltes au début du Jurassique, formant ici un plateau de 1,4 kilomètre de haut. © I, PhilippN, Wikimedia Commons, CC by-sa 3.0
Acidification et anoxie des océans provoquent une extinction de masse
La température des océans augmente ainsi de 3 à 7 °C suivant la latitudelatitude et l'augmentation des taux de CO2 dans l'eau va modifier drastiquement la chimiechimie des océans, causant une extinction de masseextinction de masse, en particulier chez les invertébrésinvertébrés marins (brachiopodesbrachiopodes, bivalvesbivalves, ammonitesammonites...). Les océans s'acidifient tandis que l'apport massif de nutrimentsnutriments via l'altération accrue des surfaces continentales va entraîner une eutrophisationeutrophisation du milieu. Des alguesalgues et micro-organismesmicro-organismes vont se développer en masse, produisant d'importantes quantités de matièrematière organique qui vont s'accumuler dans les sédimentssédiments. La dégradation de cette matière organique va cependant entraîner une forte consommation de l'oxygène dissout dans l'eau. L’oxygénation de l’océan va ainsi baisser de façon dramatique : c’est l’anoxie.
Ce nouvel épisode dramatique dans l'histoire terrestre est ainsi connu sous le nom d'Événement anoxiqueanoxique océanique du Toarcien (ou TT-OAE). Des chercheurs se sont intéressés à l'intensité et l'extension géographique qu'a atteint cet état d'anoxie de l'océan il y a 183 millions d'années. Ils se sont pour cela basés sur la quantité de certains isotopesisotopes de l'uraniumuranium dans des sédiments datant de cette époque. La composition isotopique de l'uranium dans les océans est en effet liée à l'oxygénation du milieu. Lorsqu'il y a beaucoup d'oxygène, l'uranium reste préférentiellement sous forme soluble alors qu'en situation d'anoxie, il va précipiter et entrer dans la composition des sédiments.

Les sédiments stratifiés visibles dans cette carrière (Mercato San Severino, Italie) sont des calcaires déposés dans le fond d'un océan aujourd'hui disparus, il y a 183 millions d'années. © F. Tissot
Nous filons tout droit vers un nouvel événement océanique anoxique
Les résultats, publiés dans la revue Pnas révèlent ainsi que durant le T-OAE, 6 à 8 % du fond océanique étaient dans des conditions d'anoxie. Une extension 28 à 38 fois supérieure à celle que nous connaissons aujourd'hui. Car il existe actuellement des zones anoxiques dans nos océans. Ils représenteraient 0,2 % du fond océanique. Mais l'évolution climatique actuelle laisse penser que ce chiffre pourrait augmenter dans un futur proche. Si nous sommes encore loin des taux de CO2 émis par les provinces magmatiques de Karoo-Ferrar, cette étude a cependant de quoi nous alerter. Car en seulement 200 ans, les activités humaines ont induit une émissionémission cumulée de CO2 représentant 12 % de la quantité totale émise en 300 000 ans par cette activité magmatique. Ces chiffres sont très inquiétants, car ils révèlent (encore une fois) la rapidité avec laquelle nous modifions notre environnement par rapport aux facteurs naturels. L'étude des crises passées nous montre qu'il ne faut pourtant pas un grand déséquilibre dans l'océan pour causer une extinction sévère. Quelque 6 % de surfaces anoxiques sont suffisantes. Il est donc plus que temps de limiter nos émissions de CO2, avant qu'il ne soit trop tard.