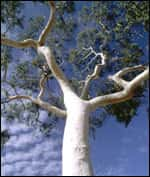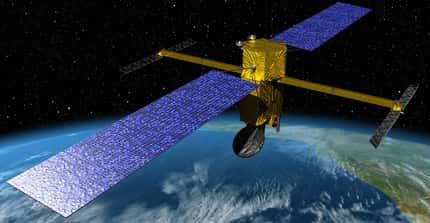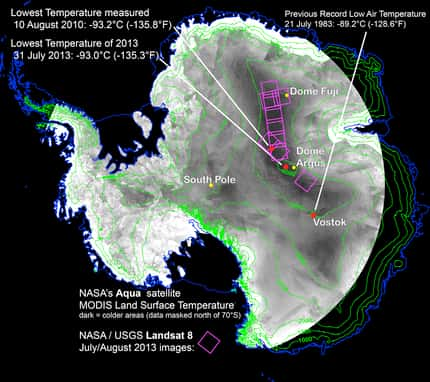au sommaire

Manchon réfrigérant permettant de simuler un gel localisé et programmé (température, vitesse et durée de congélation)© INRA/Stéphane Ploquin
L'endurcissement, une préparation de l'arbre au froid
En automne, l'arbre entre dans une phase d'acclimatation au froid, dite " endurcissement ". Au cours de cette phase, les réserves d'amidonamidon stockées pendant l'été dans le bois et l'écorce sont progressivement transformées en sucressucres, qui ont une fonction " d'antigel ". Ces sucres empêchent le contenu cellulaire de geler, ce qui aboutirait à la destruction des membranes et à l'éclatement de la cellule. L'état des réserves glucidiques de l'arbre semble donc déterminant dans sa résistancerésistance au froid.
C'est au mois de janvier-février que l'arbre est le mieux acclimaté au gel. En cas de gel précoce en automne, le tronc de l'arbre insuffisamment endurci peut présenter des nécroses de l'écorce. On l'a vu récemment dans la hêtraie ardennaise.
La sécheresse empêche l'endurcissement
Une sécheresse sévère pendant l'été diminue l'activité photosynthétique des feuilles et peut aboutir à leur perte précoce. L'arbre ne peut plus alors synthétiser et stocker de l'amidon. On s'attend donc à ce que l'arbre soit plus sensible au froid, en particulier aux gels précoces. Ce scénario s'est produit lors de la caniculecanicule de 2003 durant laquelle sécheresse et chaleurchaleur ont provoqué la chute précoce des feuilles. Il pourrait se renouveler dans le contexte du changement climatiquechangement climatique puisque l'on prédit des déficits hydriques plus fréquents en été. Ainsi paradoxalement, le risque majeur pour les arbres dans ces climatsclimats futurs pourrait être le froid qui succède aux épisodes de sécheresse.
Une expérimentation "grandeur nature"
Pour évaluer l'importance des réserves glucidiques dans l'endurcissement, les chercheurs Clermontois, en collaboration avec l'INRA de Nancy et le CNRS de Montpellier, utilisent l'expérimentation " grandeur nature " fournie par la canicule de 2003. Ils mesurent dans les forêts touchées la capacité de résistance au gel des arbres (noyers, hêtreshêtres, érables, chênes) et la mettent en relation avec l'état des réserves glucidiques. Les arbres seront suivis pendant plusieurs années car les effets d'un stressstress peuvent se prolonger jusqu'à 10 ans.
Les chercheurs développent en parallèle une étude complémentaire en chambre climatisée. Ils soumettent des arbres cultivés en conteneurs à des sécheresses et défoliations précoces et étudient la résistance des différents tissus et organes de l'arbre à des gels provoqués.
Ces travaux devraient permettre d'appréhender les risques potentiels de dépérissement forestiers, de proposer des expérimentations virtuelles pour tester les scenarii de changements climatiques et de prédire les aires de répartitionaires de répartition des espècesespèces.
Pourquoi les feuilles tombent en automne...
A l'automne, le changement de température et le raccourcissement du jour déclenchent une série d'évènements qui aboutissent à la chute des feuilles. Sous l'action des basses températures, la chlorophyllechlorophylle et certaines protéinesprotéines sont dégradées, ce qui permet de recyclerrecycler le carbonecarbone et l'azoteazote de ces moléculesmolécules sous forme de réserves de nutrimentsnutriments transférés au reste de l'arbre. La dégradation de la chlorophylle dévoile une palette de pigments à base de carotènescarotènes (orange), d'anthocyanines (pourpre), et de xantophylles (jaune) qui donnent à l'automne ses si jolies couleurscouleurs... De nombreuses enzymesenzymes et hormones végétaleshormones végétales règlent ces phénomènes. Une zone d'abscission se forme à la base des feuilles, qui tombent sous l'effet de leur poids et du ventvent. La chute des feuilles au sol permet de recycler les constituants de la matièrematière ligneuse, dégradés par les microorganismesmicroorganismes de l'humushumus et captés à nouveau par l'arbre.
La chute des feuilles en automne n'est pas une grande perte pour l'arbre d'une part parce que leur métabolismemétabolisme est très ralenti par arrêt de la photosynthèsephotosynthèse, d'autre part parce que leurs constituants sont recyclés et réutilisés par l'arbre. De plus, contrairement aux autres organes de la partie aérienne de l'arbre (les bourgeonsbourgeons, le bois), la feuille n'est pas un organe adapté au froid et se dessèche sous l'action du gel.