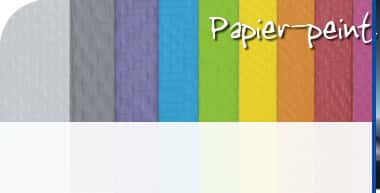La chaux est un liant obtenu par cuisson du calcaire. Grasse ou maigre, présentée en poudre ou en pâte, c’est un matériau polyvalent utilisable tant pour le gros œuvre que pour les enduits de façade ou la décoration intérieure.
au sommaire
Les chaux les plus fines s'obtiennent à partir de calcairescalcaires contenant moins de 7 % d'impuretés. Le calcaire est une roche sédimentaireroche sédimentaire à forte proportion de carbonate de calciumcarbonate de calcium. Sa cuisson (ou calcination) dans des fours spéciaux, à 900 °C, transforme le carbonate originel en oxyde de calcium et en gaz carbonique. L'oxyde de calcium, c'est la chaux vivechaux vive : une base très corrosive, inutilisable en l'état dans la constructionconstruction ou la décoration. Pour la rendre compatible, il est nécessaire de « l'éteindre » par hydratationhydratation.
Trois sortes de chaux pour les travaux du bâtiment
Parce que la chaux éteinte durcit au contact de l'airair, elle a longtemps porté l'appellation de « chaux aérienne éteinte pour le bâtiment (CAEB) ». Suite à l'harmonisation des normes françaises et européennes, on la désigne désormais par deux nouveaux sigles : CL pour calcique (Calcium Lime) et DL pour dolomitique (Dolomitic Lime). La différence entre ces deux variantes tient dans leurs teneurs respectives en oxydes de calcium et de magnésiummagnésium. La chaux calcique renferme de 70 à 90 % d'oxyde de calcium (CaO) et moins de 5 % d'oxyde de magnésium (MgO). La chaux dolomitique (CaOMgO) est plus chargée en oxyde de magnésium, dans des proportions de 34 à 41 %.

Une autre sorte de chaux est obtenue à partir de calcaires contenant de 10 à 20 % d'impuretés. Leur calcination produit une quantité importante d'aluminates et de silicatessilicates, qui durcissent d'abord au contact de l'eau puis de l'air. C'est ce que l'on appelle la prise hydraulique, qui donne au produit fini le nom de chaux hydrauliquechaux hydraulique naturelle ou NHL (pour Natural Hydraulic Lime). Le chiffre qui suit le sigle NHL sur les conditionnements indique la classe de résistance en mégapascals par centimètre cube. La lettre « Z » signifie que le produit est mélangé. Dans le cas contraire, l'emballage porte la mention « Pure ».
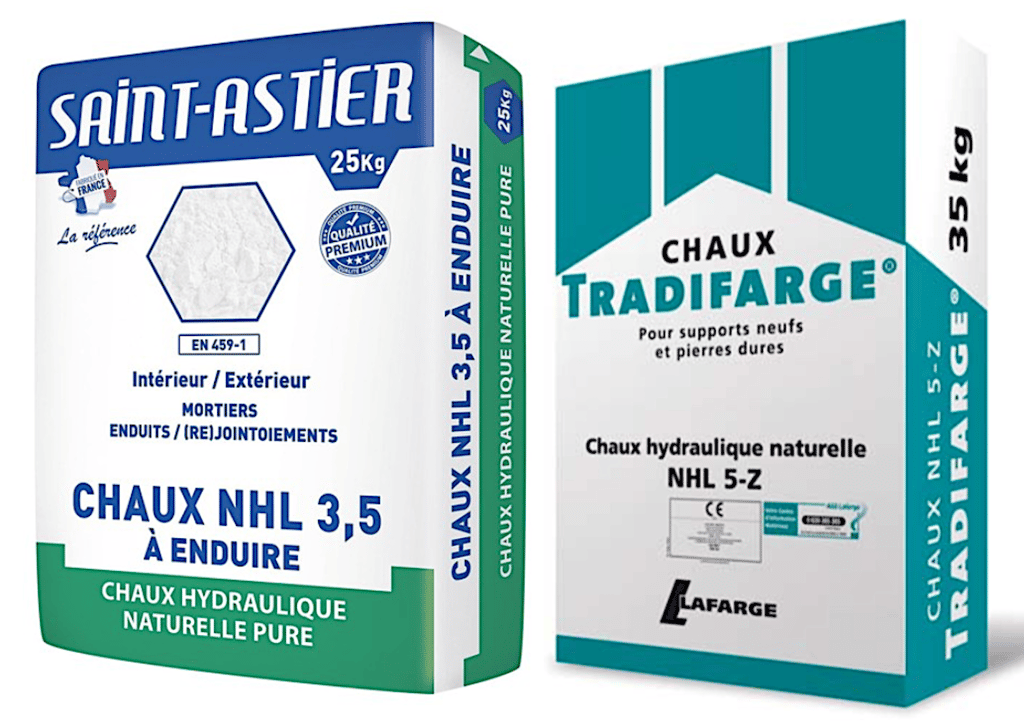
Le chaux : un produit multi-usages et multi-millénaire
L'utilisation de la chaux éteinte remonte aux premiers âges de la Civilisation. Commune à de nombres peuples antiques, elle servait à la construction (hourdage, bétons...), à l'élaboration d'enduits et de couleurscouleurs minérales pour les fresques. Les techniques se sont perpétuées en s'affinant au long des siècles. La chaux peut ainsi s'employer seule ou bâtardée (mélangée à parts égales de ciment) pour confectionner d'excellents mortiers de maçonnage. Adhérente, microporeuse, elle constitue le matériaumatériau de base des enduits traditionnels deux ou trois couches, du stuc ou du tadelakttadelakt. Le séchage se faisant toujours de l'extérieur vers l'intérieur, les mortiers à base de chaux durcissent lentement, en plusieurs semaines. Cette apparente contrainte est en fait un atout, car on peut ainsi préparer de grandes quantités sans risque d'altération du mélange. La chaux s'utilise aussi en peinture ou sous forme de badigeonbadigeon et peut être associée à du plâtreplâtre pour réaliser des revêtements décoratifs et des ornementations en relief (cornichescorniches, frises, rosacesrosaces...).
Ce qu’il faut
retenir
- La chaux est économique à l’usage. À surface égale, son dosage est de 40 à 50 % inférieur à celui d'un ciment ordinaire.
- En durcissant, elle se « recarbonate » au contact du gaz carbonique de l'air. Autrement dit, elle retrouve peu à peu son état calcaire originel, renforçant ainsi son pouvoir protecteur.
- La chaux est également un très bon ignifuge, capable de résister à des températures plus élevées que le ciment.