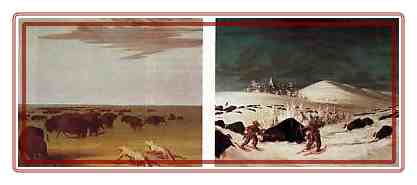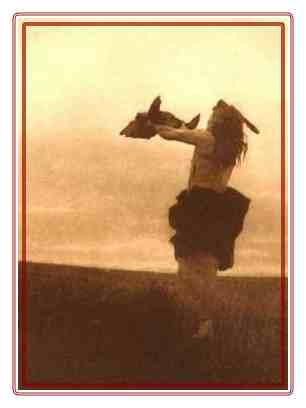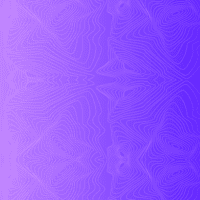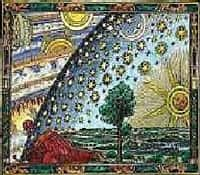au sommaire

La vie sociale
- 1°) La Générosité
En effet, l'accumulation de biens pour son propre profit était aussi déshonorante que le fait d'être incapable d'acquérir des richesses était pitoyable. La notion de propriété n'avait d'importance que parce qu'elle permettait de donner.
La règle voulait qu'on ne refuse pas un cadeau offert et qu'on en fasse un en retour même s'il devait s'agir d'un présent modeste.
Les Sioux se faisaient donc un devoir d'offrir. Les jeunes apportaient de la nourriture aux anciens, les chasseurs partageaient avec les infirmes, les hommes offraient des cadeaux aux orphelins...
La générosité, érigée en en vertu principale, permettait aux individus de comprendre l'abondance. On ne connaissait pas le principe de l'héritage, c'était durant sa vie que l'on distribuait des biens matériels. La redistribution des richesses participait à une norme économique égalitaire au sein de la tribu. Ainsi, les indigents n'étaient pas des fardeaux pour la société mais un vecteur nécessaire pour ceux qui voulaient acquérir un rang social par le moyen du don.
Le don pouvait être informel, mais donnait également lieu à des cérémonies.
Par exemple le otu'hau traduit en anglais par give away et que nous traduirons par dénantissement était l'occasion de montrer sa générosité (une vertu rare de nos jours)
Cette cérémonie reposait sur un concept de confiance réciproque et, de plus, était partie intégrante du système économique des Sioux. Donner impliquait de recevoir et la seule équivalence admise était celle de l'intention et non de la valeur marchande. De plus, celui qui voulait être considéré devait donner beaucoup, donc produire beaucoup, donc chasser et avoir dans son cercle familial d'habiles artisans. Plus il donnait, plus il était un personnage digne d'intérêt et susceptible d'accéder, s'il en était capable, à de hautes fonctions. La cérémonie consistait donc, à l'occasion d'un événement familial marquant, à donner TOUT ce que l'on possédait aux autres membres de la tribu, sachant que l'on recevrait une contrepartie permettant de ne pas être dans le dénuement ! Bel exemple de confiance et de cohésion d'une société.
L'individu n'existait que par sa valeur personnelle et prouvait dans cette circonstance qu'il était au dessus des contingences matérielles et qu'il faisait partie intégrante du groupe.
Nous vous conseillons la lecture du livre de R.B. HASSRICK "Les Sioux" aux éditions Terre Indienne où vous pourrez retrouver toutes les informations relatives à la morale des Sioux.

- 2°) La propriété
C'était une notion bien réelle. Chaque individu possédait quelque chose mais les droits de propriété étaient précisément définis. Si un homme capturait un troupeau de vingt-cinq chevaux, ils étaient siens. Si une femme tannait et cousait un tipi, il était sien. On pouvait acheter des boucliers, des prescriptions médicales, des flèches et des robes. On donnait aux enfants des poupées, animaux et des chevaux dont ils avaient ensuite l'entière responsabilité. Il n'était pas question de mettre en doute leur droit à la propriété.
On n'encourageait pas l'augmentation du patrimoine au-delà de ce qui était nécessaire pour vivre normalement. Au contraire, l'idéal de générosité que l'on prônait, associé aux honneurs rendus à ceux qui se défaisaient de leurs biens, rendait les offrandes impératives.
L'homme qui possédait de nombreux chevaux et qui les conservait comme un trésor dépassait les convenances, c'était un égoïste. A moins qu'il n'ait des vertus compensant ce défaut, son prestige était bien moindre que celui accordé à l'homme qui donnait sans cesse des chevaux. La propriété était faite pour qu'on l'utilise et non pour qu'on thésaurise. Son principal usage était d'en faire don à autrui.
Par conséquent, la richesse résidait dans l'habileté qu'avait l'homme d'accumuler des biens pour les distribuer ensuite. Ce principe restait opératif du fait qu'il était bien entendu que recevoir un cadeau impliquait d'en donner un en retour. Il n'était pas nécessaire que le cadeau fut retourné sous une certaine forme ou sous un délai particulier. Mais, à l'exception peut-être des vieux et des déshérités, on attendait un signe de paiement. La richesse n'était donc pas une fin en soi, mais un moyen. La société mettait un frein à l'inclinaison naturelle de l'homme à posséder afin que ceux qui étaient le moins capables d'acquérir les éléments essentiels ne souffrent pas de privation. L'homme généreux recevait les acclamations de tous alors que le miséreux était objet de dédain.
Le schéma consistant à se défaire de (tous) ses biens était cristallisé de façon bien plus rigide que ne l'aurait été un simple don de cadeau. Il était bien plus frappant d'organiser de façon formelle un ensemble de cérémonies et de terminer chacune d'elles par un Otu'han. Chacun d'eux exigeait d'avoir accumulé une myriade de cadeaux avant que l'on puisse s'y soumettre. Pour parvenir à une fonction donnant une certaine autorité sur les autres, il était nécessaire de s'acquitter de cérémonies ayant rapport à certains passages critiques de la vie, particulièrement la pubertépuberté et la mort. Il existait un classement relativement ouvert et qui fonctionnait de telle sorte qu'un individu devait célébrer deux des quatre cérémonies initiales avant d'accomplir les deux dernières. Le prix de chacune d'elles, en termes de cadeaux, était considérable. Certains hommes ne pouvaient s'en permettre qu'une seule dans toute leur vie. Seule une élite pouvait accomplir les quatre cérémonies indispensables. Et la richesse, c'est à dire l'aptitude à donner, était loin d'être seule nécessaire au préalable ! Pour avoir le droit de se soumettre aux deux dernières étapes du rite d'initiation, encore fallait-il être choisi par ceux qui les avaient déjà accomplies. Ces derniers constituaient la classe des chefs. On les connaissait sous le nom de Wicasas.
Si un homme avait l'intention de briguer une place éminente dans son groupe, il lui fallait d'abord donner pour sa fille la Isnati Alowanpi, qui peut se traduire par "chanter pour les premières règles". Puis la Tatanka Alowanpi, c'est à dire "chanter le bison" ou encore la Tapa Wanka Heyapi, c'est à dire "lancer la balle". Il devait aussi accomplir soit pour son fils soit pour sa fille la Hunka Yapi, c'est à dire "agiter la queue du cheval ". S'il n'avait pas d'enfant, il pouvait en adopter un à cet effet. Puis, s'il était choisi, il devait accomplir la cérémonie de "Possession du fantôme" et pour finir la "Cérémonie du Bison blanc". Les interpénétrations au sein de cet ensemble de cérémonies, de même que le modèle du Otu'han, imposaient aux chefs d'être bienfaisants. Les idéaux de cette société maintenaient cette nécessité tout en protégeant ses membres de l'exploitation que leur chef pourrait faire d'eux.

- 3°) Le Mariage
"Un homme pouvait épouser autant de femmes qu'il le souhaitait - à la seule condition qu'il pût les nourrir. Certaines d'entre elles valaient peu de prix alors que d'autres étaient très chères."
Un homme pouvait donc épouser jusqu'à six femmes, bien que la chose fut plutôt inhabituelle ; en effet, nourrir autant d'épouses, les abriter dans deux tipis, voire plus, était une responsabilité assez pesante économiquement pour décourager les plus hardis. Les hommes désireux de ce genre d'union se contentaient en général de deux épouses, et choisissaient fréquemment de se marier à l'une des soeurs cadettes de leur première épouse.
La polygamie n'était en aucun cas synonyme de discrédit social pour les femmes ni de diminution de leurs droits. Dans bien des cas, elle était suggérée par la première épouse qui, en invitant son mari à prendre une plus jeune femme, cherchait à se débarrasser de certains fardeaux domestiques, tout en gagnant dans l'affaire le statut avantageux de première épouse d'un homme prospère. Car il était de notoriété publique que seuls les riches pouvaient se permettre d'entretenir plus d'une épouse. Le sororat, institution par laquelle un homme peut épouser deux soeurs, avait l'avantage de rassembler au sein d'une même famille conjugale des jeunes femmes liées par le sang et par une amitié de longue date. Bien plus, elle renforçait les liens de la famille. Dans ce cas-là, l'influence de la branche féminine surpassait, ô combien, celle de l'époux et, quand la résidence était située sur le territoire de la famille de la femme, la cohésion de la bande des femmes était démultipliée. Un mariage organisé de cette façon et conjugué au pluriel signifiait pour la famille l'apport d'un homme responsable et vigoureux, exactement ce que l'on peut attendre d'un beau-frère.
Bien qu'elle ne fut pas obligatoire, on espérait bien que la polygamie serait pratiquée dans une circonstance au moins. A la mort de son frère, un homme était invité à épouser sa veuve. Dans ce cas-là, lorsque le frère survivant était déjà marié et que le défunt vivait une situation de polygamie laissant plus d'une seule veuve, le mariage avec plusieurs femmes devenait inévitable. Ce serait déraison de penser que tous les hommes sautaient sur l'occasion d'épouser la veuve de leur frère. Il est plus probable que certains d'entre eux redoutaient plutôt l'idée de survivre à celui-ci.