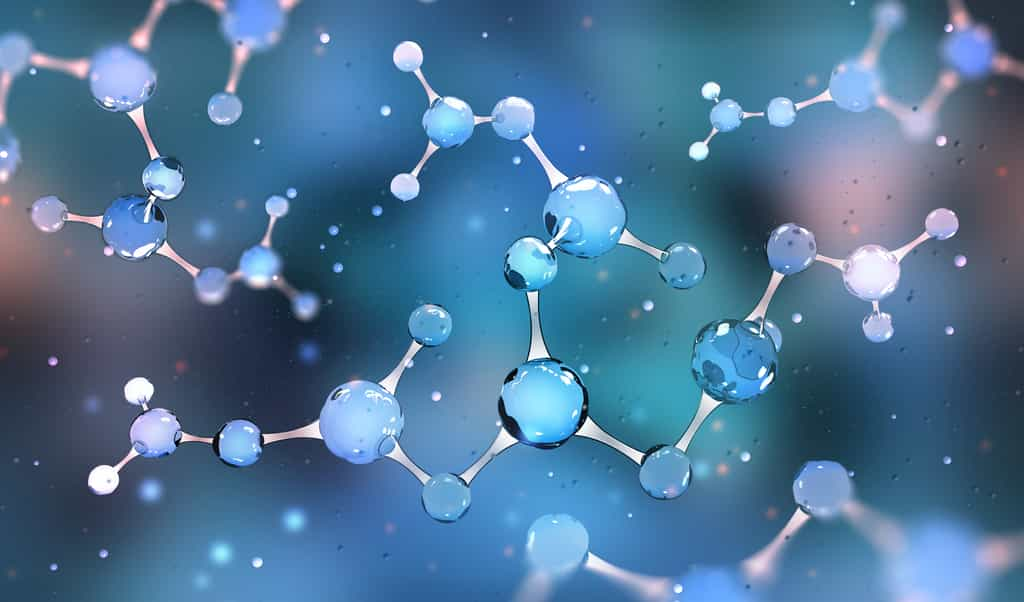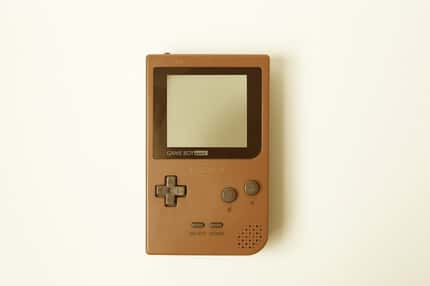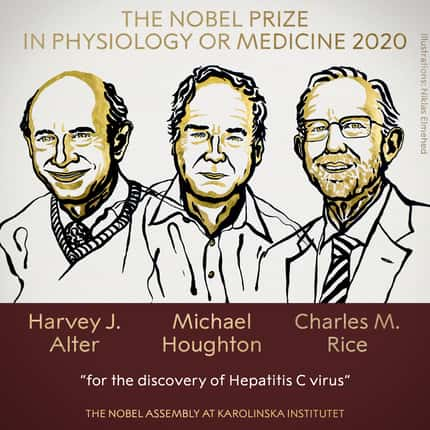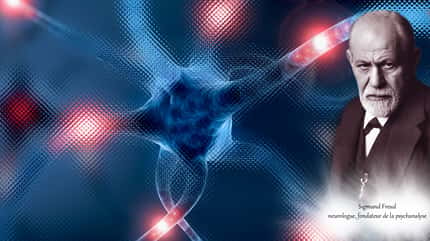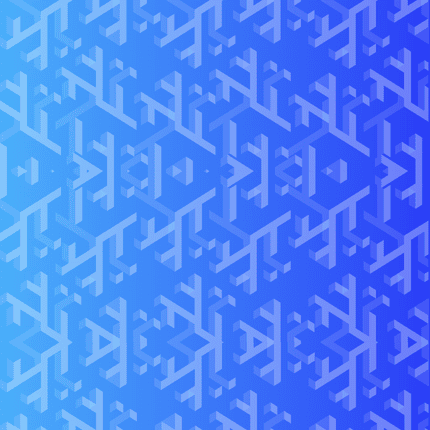au sommaire
- Une Nanoparticule c'est quoi ?
- Une particule à l’échelle nanométrique
- Des nanoparticules naturelles ou artificielles
- Comment fonctionnent les nanoparticules?
- Les avantages des nanoparticules
- Les domaines d’application des nanoparticules
- Quels sont les dangers des nanoparticules ?
- Les nanoparticules peuvent se révéler toxique pour l’organisme humain
- Elles peuvent être toxiques pour les organismes non-humains
- À lire aussi
Les nanoparticules sont des éléments ayant une taille nanométrique, entre 1 et 100 nanomètresnanomètres (1 nanomètre est 1000 millions de fois plus petit qu'un mètre). L'échelle est de l'ordre des moléculesmolécules.
Utilisées dans tous les domaines depuis les années 90, les nanoparticules sont de plus en plus présentes dans notre quotidien (cosmétiques, peinture, électronique, informatique...).
Les nanotechnologies reçoivent chaque année d'énormes budgets d'investissement en recherche et développement. C’est donc un secteur en forte croissance. Dominique Vinck, sociologue des sciences et de l’innovation, nous parle de la révolution nanotechnologique. © Futura-Sciences
Elles pourraient même être utilisées en médecine, où leur fonction serait de délivrer spécifiquement des médicaments aux cellules qui en ont besoin, et en évitant les cellules saines, par exemple dans le traitement des tumeurstumeurs.
Une Nanoparticule c'est quoi ?
Une nanoparticule est une particule qui correspond à un milliardième de mètre. Elle peut être naturelle ou artificielle et possède généralement des propriétés spécifiques.
Une particule à l’échelle nanométrique
Le nanomètre correspond au milliardième du mètre. Il est abrégé en nm. C'est l'équivalent d'un cinquante millième du cheveu humain. On approche ainsi l'universunivers de l'infiniment petit auquel avait réfléchi le philosophe Blaise PascalBlaise Pascal au XVIIème siècle. La nanoparticule, qui n'est pas visible à l'œilœil nu, circule dans l'environnement. On classe les nano-objets en trois catégories en fonction de leurs dimensions :
- les objets dont une seule dimension se situe à l'échelle nanométrique et les deux autres dimensions nettement supérieures. Il s'agit des nano-plaquettesplaquettes, des nano-feuillets et des nano-plats,
- les objets dont deux dimensions sont d'échelle nanométrique. Seule la troisième est de taille supérieure : on y inclut les nanofibres de polyester, nanotubesnanotubes de borebore ou de carbonecarbone,
- les objets dont les trois dimensions sont à l'échelle nanométrique : nanoparticules d'oxyde de zinczinc, d'aluminealumine, de carbonate de calciumcarbonate de calcium, etc.
Des nanoparticules naturelles ou artificielles
Il existe des nanoparticules naturelles à l'instar de la Yersina pestis à l'origine de la PestePeste Noire qui fit 25 millions de morts en Europe entre 1347 et 1352, soit l'équivalent de 30% à 50% de la population. Elle doit son nom au médecin franco-suisse Alexandre Yersin qui la découvrit en 1894.
Certaines d'entre elles sont directement fabriquées par l'homme et notamment les particules utltra-fines issues des moteurs à combustioncombustion.
Comment fonctionnent les nanoparticules?
Les avantages des nanoparticules
On nomme nanomatériaux manufacturés, les nanoparticules que la science fabrique intentionnellement, le plus souvent pour susciter des propriétés qui n'existent pas dans les mêmes matériaux à l'échelle macro ou microscopique. Ainsi, l'or se muemue en catalyseurcatalyseur de réactions chimiquesréactions chimiques à l'échelle nanométrique. On peut créer, de la sorte, quantité de propriétés :
- le nano-argentargent pour les antibiotiquesantibiotiques,
- les luminophores qui émettent de la lumièrelumière et présentent des vertus optiques applicables dans la détection de rayons Xrayons X,
- les nanoparticules d'or sont anticancéreuses,
- l'atomeatome de gadoliniumgadolinium possède des propriétés magnétiques,
- l'atome de bore ou de cadmiumcadmium peut anéantir des neutronsneutrons.
Les domaines d’application des nanoparticules
Les nanoparticules sont exploitables dans toutes sortes de domaines et cette liste n'est pas exhaustive :
- médecine et pharmacie : imagerie médicale, anti-allergènesallergènes, vaccinsvaccins oraux, etc.,
- aéronautique et aérospatial : lutte contre la corrosioncorrosion, les salissures, les rayures, allègement des matériaux, qualité de la peinture, etc.
- cosmétique : pâtes à dentifrice, crèmes solaires, maquillage, etc.
Quels sont les dangers des nanoparticules ?
Les nanoparticules sont potentiellement toxiques pour les êtres vivants.
Les nanoparticules peuvent se révéler toxique pour l’organisme humain
Les nanoparticules toxiques peuvent être absorbées par l'ingestioningestion, l'inhalationinhalation ou le passage transcutané lorsqu'elle est mise au contact de la peau.
Elles sont susceptibles de générer des asthmesasthmes et gagner les alvéoles pulmonaires. Les particules ultrafines peuvent exercer un stressstress oxydant sur les êtres humains. La pollution les démultiplie.
Elles peuvent être toxiques pour les organismes non-humains
Elles peuvent altérer la croissance de plantes comme le sojasoja et entraîner en retour des répercussions dommageables pour le consommateur.